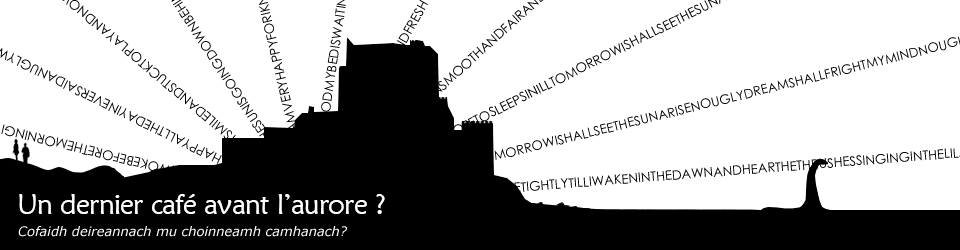"Pourquoi le présent est-il souvent peint de couleurs plus sombres qu'un passé pourtant difficile et qui devient presque chatoyant dans la parole-source ?" (Danièle Voldman)
Donc voilà : depuis ce matin, à mon travail, j'essaie (entre une réunion, un appel d'offre à finaliser et une demande de renfort – tombée à l'eau – pour démonter/transporter de vieilles étagères déglinguées) de me concentrer sur la réécriture d'un texte à rendre pour l'année dernière, voire même pour l'année d'avant (très gros soupir). Sans entrer dans les détails techniques, le texte en question traite de sources orales, de maisons du peuple (pour une fois pas celle de Saint-Gilles – qui n'en est plus une, d'ailleurs) et de portail Web consacré à la mémoire orale. Un sujet intéressant mais... je suis en retard, en retard, en retard ! Si ça continue, on va me couper la tête.
Peu importe. Je me replonge donc dans le monde encore en partie à défricher des sources orales, ces documents sonores un peu à part, souvent mésestimés, en marge des sources écrites "traditionnelles". Dans le cas présent, il s'agit d'une série d'interviews historiques ou anthropologiques, plus ou moins cadrées, de témoins d'une époque, d'un lieu, d'un événement. Chose amusante, que l'on retrouve dans beaucoup d'études basées en tout ou en partie sur l'oralité : les témoins sont plus ou moins conscients d'être acteurs ou spectateurs des événements qu'ils vivent. Ainsi l'historienne Danièle Voldman – toujours elle – fait-elle la différence entre un "grand témoin" et un "petit témoin" (ce n'est pas moi qui le dis : c'est dans les notes qu'on m'a transmises). Le premier, dit aussi "témoin-sujet", a pleinement conscience d’avoir joué un rôle dans une structure donnée, d’avoir laisser son empreinte personnelle dans les événements qu’il décrit ; le second, au contraire, est un "témoin-objet" et considère n’avoir été qu’un spectateur (et non un acteur), un pion parmi tant d’autres des événements qu’il narre.
En outre, en compulsant les quelques notes qui sont à ma disposition, je tombe sur des réflexions intéressantes concernant la mémoire, cette petite fée espiègle qui nous joue constamment des tours. Ainsi, quand un témoin raconte un événement plus ou moins ancien, il faut avoir à l'esprit que ce qu'il raconte n'est pas la vérité (c'est presque une évidence, certes) mais bien la façon dont il a vécu l'événement, avec ses espérances du moment, sa propre logique, ses propres structures de pensée. Pire : avec le temps, la mémoire déforme l'événement de manière à réadapter celui-ci au présent. Seul compte le présent : la mémoire est un instrument de survie, pas un élément au service de l'Histoire. Pour faire une dernière analogie, la mémoire ne fonctionne pas comme un disque dur : elle ne stocke pas simplement une suite d'informations sans les modifier. Au contraire, elle réinterprète constamment les observations, elle les passe au travers d'un prisme déformant. On en revient presque à la résilience : la mémoire peut déformer un souvenir traumatisant de manière à ce qu'il soit pleinement accepté ; mais elle peut aussi tout simplement déformer un souvenir banal pour donner plus ou moins d'importance à une action personnelle à un moment donné (ha, cette putain d'estime de soi !).
En creusant encore un peu plus, la mémoire pose la question de ce qu'est le passé, en opposition avec ce qu'est le présent. Le passé n'est que le souvenir qu'on en garde ; le présent est aussi impalpable que des grains de sable s'échappant d'une paume... Entre les deux, où nous situons-nous ? Et où se situe l'historien, censé être le plus "vrai", le plus "juste" possible ? (Et comment s'est-il débrouillé, Thucydide ? Merde !) Chaque lettre que je tape sur ce clavier appartient déjà au passé... Et le "Carpe diem" cuisiné à toutes les sauces et lâché à la va-vite sur Facebook est sans doute beaucoup plus difficile à atteindre qu'il n'y paraît de prime abord. Souvenir : une nuit, seul, revenant d'une soirée dont j'ai tout oublié (encore cette fichue mémoire), marchant dans une rue de Bruxelles, Like Spinning Plates en boucle dans les oreilles, de gros flocons tapissant le paysage : là, pendant un court moment, le temps s'est réellement arrêté ; je me suis assis sur un banc couvert de neige et j'en ai vraiment profité. Mais ce n'est encore qu'un souvenir, un simple souvenir...
Dommage que je ne puisse pas aligner tout cela tel quel dans un article "scientifique", sans la vérification constante de quelques collègues scrutant la moindre faille dans mon argumentation.
* * *
Dans le train vers Bruxelles, avec Yama, nous parlons de cinéma. Yama est un "rouleau-compresseur" en ce qui concerne le septième art (pas que pour le septième art, d'ailleurs)... Autrement dit : elle connaît tout. J'exagère sans doute, mais je la considère, avec Flippo (qui a fait ELICIT – Arts du spectacle, orientation écriture et analyse cinématographiques) et mon chef Lodewijk (qui a travaillé plus de dix ans à la Cinémathèque royale), comme mes trois références en matière de cinéma. (Je sais que Flippo et Yama lisent de temps en temps – voire tout le temps – ce blog, du coup je suppose qu'ils vont s'indigner de la réputation que je leur fais ici, mais tant pis !)
Yama me demande si j'ai vu de bons films récemment (elle demande ça à tout le monde pour le moment, me dira-t-elle). Réponse : non, je n'ai rien vu qui en vaille la peine (faut dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu une phase "cinéma" intensive). Dernièrement, pour sa part, Yama a (re)vu Éclipse d'Antonioni et Stalker de Tarkovski. Éclipse : un film d'actualité (rien ne change !), quand on connaît la frénésie de certaines personnes (même parmi les proches amis) quant à l'activité boursière. Stalker : c'est un chef-d'œuvre ; il faut le voir, point. Ci-dessous le superbe final en noir et blanc d'Éclipse et celui, non moins superbe, de Stalker, juste pour le plaisir des yeux (il n'y a pas ici de "spoiler", ni de révélation finale : juste une esthétique hors du commun).
Ce n'est pas la première fois que nous en parlons, mais nous en parlons quand même : le fantastique Blade Runner de Ridley Scott, un des films dans le top 3 de Yama (jamais je n'ai eu l'idée de lui demander quels étaient les deux autres films du top). Blade Runner : un mélange de mélancolie et de perfectionnisme.
La mélancolie d'abord : aucun humain dans ce film n'est heureux. Rick Deckard (Descartes ?), le chasseur de réplicants, est forcé de reprendre du service, sans entrain : il arbore ainsi toujours une moue soit mélancolique, soit cynique par rapport à sa quête ; Elron Tyrell est un génie solitaire, magnat gouvernant de très haut son empire technologique ; J.F. Sebastian, designer souffrant du syndrome de Mathusalem, est un nerd qui vit seul, en dehors du monde, avec pour seule compagnie ses jouets... Les seules personnes qui essaient de vivre leur vie coûte que coûte sont les réplicants eux-mêmes, ces androïdes plus vrais que nature, à la durée de vie limitée, qui passent pour les vilains méchants au début du film. À la fin, retournement de situation lorsque Roy Batty, le dernier réplicant renégat en vie, sur le point de mourir, sauve Deckard (censé être son ennemi), lui déclamant la célèbre phrase : "J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir". La citation est presque un équivalent futuriste du Bateau Ivre de Rimbaud : "J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur (...)". Une réminiscence de Cordwainer Smith, aussi.
Des non-humains doués d'empathie... Qui est humain et qui ne l'est pas ?
Ensuite, le perfectionnisme : dans Blade Runner, d'après Yama, tous les objets du film, y compris les plus insignifiants – c'est-à-dire présents ne fut-ce qu'une seconde à l'écran – ont été choisis avec le plus grand soin, parmi les plus avant-gardistes de l'époque. Cette volonté perfectionniste, on la retrouve jusqu'à l'art des origamis laissés par Gaff tout au long du film...
Faudra que je reparle de Blade Runner un de ces jours... Si aujourd'hui je continuais sur ma lancée, non seulement mes rares lecteurs me diraient à nouveau que c'est trop long blablabla, mais en plus je finirais par m'endormir sur mon clavier, laissant une série de "zertfgyiokpomlkiujygfrtvdc" (c'est ce qu'écrit toute seule ma tête lorsque je la pose aléatoirement sur mon ordinateur portable).
Comme dirait l'autre : il est temps de dormir.