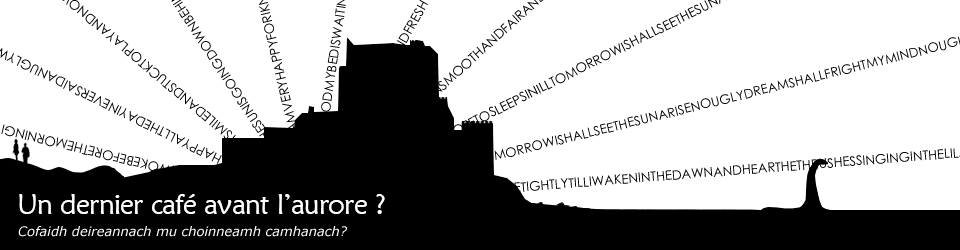Archives mensuelles : mars 2012
Croot ?
Ainsi, à quinze ans environ, dans les bacs de la Fafouille à Charleroi, de diverses foires, de bibliothèques ou de librairies, il empruntait ou achetait ce qu'il voulait, dans la mesure des moyens financiers de ses parents. Et c'est ainsi que, au hasard des rencontres, il est tombé sur L'Incal de Moebius et Jodorowsky, sur Arzach et sur d'autres œuvres qui ont changé sa façon de voir la bande dessinée...
Anecdote : un jour, ce même gamin eut la mauvaise idée d'apporter Arzach à l'école... La BD tomba dans les mains d'une prof d'anglais, qui s'exclama alors : "Mais c'est de la pornographie !". Réponse : "Hein ? Quoi ? Mais pas du tout ! C'est de l'art !" Alors la prof ouvrit une page représentant un homme à poils assis sur un banc rappelant un phallus, ainsi qu'une autre sur laquelle une jeune femme aux seins nus était en train d'enlever (ou de remettre ?) sa petite culotte. La prof retorqua : "Non, c'est bien de la pornographie !", mais rendit quand même, en souriant, la BD à l'adolescent...
Histoires d'amour enfantines
Je regarde Gaëlle jouer par-dessus la grille de la cour de récréation du lycée de Namur et lui fais de grands signes de la main. Elle me remarque, paraît toute contente de me voir et se dirige vers la sortie, non sans m'avoir au préalable montré du doigt au petit garçon qui jouait avec elle. Celui-ci, un petit blond aux yeux bleus et aux cheveux courts, se rapproche de la grille :
« Bonjour M'sieur !
— Salut !
— Vous êtes le papa de Gaëlle ?
— Ouaip.
— Moi, c'est Alder !
— Ha ! C'est toi le copain de ma fille ?
— Oui.
— C'est bien, ça... »
Il me regarde, je le regarde... Il ne se passe plus rien. Après quelques secondes, Alder s'en va dire un mot à Gaëlle qui est alors en train de chercher son cartable dans la masse informe de mallettes à l'entrée du bâtiment. Ensuite, il retourne courir dans la cour comme si de rien n'était et je le perds de vue.
À la sortie, ma fille me lance :
« Tu as parlé au garçon que je t'ai envoyé ?
— Oui, oui...
— Il s'appelle Alder et c'est mon amoureux.
— Je sais.
— Avant, il avait deux autres amoureuses, mais il les a plaquées. C'est bien comme ça qu'on dit ? "Plaquer" pour "quitter" ?
— Euh oui... C'est bien ça...
— Il était avec Violette mais elle a changé de classe, et avec Aline aussi, mais elle est partie, elle. Alors il ne reste plus que moi... »
Je suis complètement largué...
Histoires de cadres
— C'était en rapport avec les récents dérapages de Claude Guéant...
— Mais ne pas répondre alimente le fantasme, justement ! Ça donne l'impression que le sujet est tabou. Et pendant ce temps, la droite occupe le débat... »
— On te dit quoi, par exemple ?
— Ce type est fou...
— Ils sont quelques uns comme ça... Ils se déguisent en soldats américains et vont à toutes sortes de commémorations.
— Mmmmh...
— Ils sont parfois un peu vieux jeu ?
— Ils sont corporatistes jusqu'au bout des ongles !
— Ha oui, le corporatisme...
— Ne rien donner pour rien. Tout contrôler. Accès Web restreint, tout ça...
— Oui, tu m'en avais déjà parlé. C'est clairement une erreur d'être comme cela aujourd'hui...
— Et puis, ils sont dans le monde des détails, du genre : "Ne faudrait-il pas utiliser le verbe pouvoir au lieu de devoir au 17e alinéa de l'article 45ter de la troisième version corrigée des statuts ?" Je ne me sens pas à ma place là-dedans... »
"Ils sont méchants, les wittgensteiniens"
Premier extrait : Gilles Deleuze dans son Abécédaire... Je l'avais déjà visionnée en entier, cette longue et fascinante vidéo dans laquelle Deleuze revient pour nous parler "d'entre les morts" — car le philosophe, qui a toujours refusé toute apparition télévisuelle, a demandé expressément que cet abécédaire soit diffusé après son décès —, mais je n'avais curieusement pas relevé à sa juste valeur le "W comme Wittgenstein"...
Retranscrite, la discussion donne ceci :
« Alors, passons à "W"... Et "W" ?, demande Claire Parnet.
— Y a rien à "W", rétorque Deleuze.
— Si. C'est "Wittgenstein" ! Je sais que c'est rien pour toi mais je voudrais juste un mot...
— Ha ouais, non, non. Ça, je ne vais pas parler de ça. Oui. Pour moi, c'est une catastrophe philosophique. C'est le type même d'une école : c'est une régression de toute la philosophie à des... une régression massive de la philosophie. C'est, c'est très... c'est très triste, "l'affaire Wittgenstein". Ils ont foutu un système de terreur, où tout a... où sous prétexte... sous prétexte de faire quelque chose de nouveau... Mais c'est la pauvreté instaurée en grandeur ! C'est la... enfin, c'est... ça n'a pas, ça n'a pas... Y a pas de mot pour décrire ce danger-là. Ouais... C'est un danger qui revient... C'est pas la première fois que c'est survenu mais c'est grave ! Surtout qu'ils sont méchants, les wittgensteiniens. Et puis ils cassent tout ! Si... s'ils l'emportent, alors, là, il y aura un assassinat de la philosophie. S'ils l'emportent ! C'est des assassins de la philosophie, ouais.
— Mais c'est grave.
— Ouais, ça... Faut... faut une grande vigilance ! »
Rien d'étonnant à ce que Deleuze, quand il mentionne Wittgenstein, parle d'assassinat de la philosophie car tout — absolument tout — les oppose, d'une certaine manière... Pour Deleuze, la philosophie est positive, créatrice : "La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts", écrit-il dans Qu'est-ce que la philosophie ? (1991), et "n'a strictement rien à voir avec une discussion". Pour Wittgenstein, la philosophie est négative (elle ne fait que définir les limites de ce qui peut être dit) et "laisse toute chose en état" (l'expression est de lui). Wittgenstein n'invente à proprement parler aucun concept et — comble de l'horreur pour Deleuze ! — se situe presque toujours dans la discussion.
Quand je lis Wittgenstein, j'ai l'impression que ce dernier écrivait de la philosophie pour en finir une bonne fois pour toute, pour tarir ce flot de réflexions et de non-sens qui paralyse la (sa ?) pensée (la philosophie comme thérapie). Wittgenstein a été instituteur, jardinier, architecte : comme si les choses importantes se trouvaient dans l'action, au-delà de ce qui peut être dit.
« Hamilton ! Tu avais précisé : "Dérivés de Wittgenstein". Dé-ri-vés. Ce n'est plus un dérivé, là...
— Oups, désolé ! »
En présentant le Tractatus logico-philosophicus, l'émission de France Culture susmentionnée a repris l'extrait sonore d'un film, Crimes à Oxford (The Oxford Murders, 2008), que je ne connaissais pas et que je n'ai — je l'avoue — pas du tout envie de connaître : on y "voit" Wittgenstein durant la Première Guerre mondiale sous le feu ennemi, en train d'écrire son texte philosophique. Quelle connerie ! C'est encore plus ridicule que le "Wittgenstein s'extasiant sur le monde", en pleine page et en pleine guerre mondiale, dans la BD Logicomix. Dans l'extrait de film en question : un professeur d'université pédant et pas du tout crédible (John Hurt) qui ne fait que réciter de grandes phrases vides de tout contenu et qui s'oppose à un étudiant (Elijah Wood) qui croit "au nombre Pi", autrement dit à l'essence mathématique du monde... C'est d'un médiocre : un ramassis de boursouflures et de grandiloquence déplacée.
Pour terminer dans la bonne humeur : Mauri Antero Numminen, artiste finlandais, chantant le Tractatus logico-philosophicus. "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." Woaw ! Fallait oser !
Virus en tous genres
Hamilton passe donc sa journée de mardi à résoudre ce problème et ça l'énerve prodigieusement car il n'a pas que ça à foutre, bordel.
— Ha, ça tombe vraiment bien ! J'ai presque fini celui que je suis en train de lire...
— Le livre de Bear, là, Darwin, euh... ?
— Oui, j'ai lu 500 pages sur 700.
(Je sors mon téléphone et recherche la note contenant les deux auteurs préconisés par Jonas.)
Nancy Kress (née en 1948) : romancière américaine connue entre autres pour sa nouvelle L'une rêve et l'autre pas (Beggars in Spain, 1991, prix Hugo et Nebula ! — Je l'ai lue mais je ne m'en souvenais plus !) et aussi pour sa Trilogie de la Probabilité (Réalité partagée [Probability Moon, 2000] ; Artefacts [Probability Sun, 2001] ; Les Faucheurs [Probability Space, 2002]), l'histoire d'une humanité qui s'est propagée à travers la Voie lactée à l'aide de tunnels spatiaux construits par une race extraterrestre aujourd'hui éteinte mais qui aurait dans un lointain passé "ensemencé" la Galaxie, de telle manière que les nombreuses espèces intelligentes connues possèdent un corps et un ADN grossièrement similaires à ceux des humains. Les différents résumés que j'ai sous les yeux me font directement penser — peut-être à tort — au Cycle de la Grande Porte de Frédéric Pohl et me donnent envie de commander les trois romans, et ce malgré une critique assez (voire très) négative du Cafard cosmique, selon laquelle le deuxième volet (Artefacts donc) serait "un roman fade, inodore et incolore". À suivre...
Kierkegaard et les chevaux
L'auteur de l'article évoque Phèdre de Platon, dans lequel il est question du mythe de l'Attelage ailé, constitué de trois éléments, trois parties de "l'âme humaine" : le cocher (le noûs, la plus haute et la plus noble des trois parties, symbolisant le cerveau, l'esprit, l'intelligence), qui doit constamment contrôler le cheval blanc (le thumos/thymos, le sang, le souffle, le cœur, la colère, attiré par le ciel) et le cheval noir (l'epithumia, la partie la plus basse, symbolisant le ventre, l'appétit, les envies terrestres). L'attelage des dieux n'a pas ce problème : il n'est tiré que par des chevaux blancs, au mouvement ascendant. Mais celui des hommes est en lutte constante, tiraillé entre le cheval blanc, obéissant, se dirigeant vers le ciel (le monde des idées) et le cheval noir, indomptable, au mouvement descendant, terrestre (le monde matériel)*.
Kierkegaard utilise la métaphore des deux chevaux pour exprimer l'angoisse de l'humain face à la conscience de son existence et à la vision vertigineuse de sa propre liberté. En réaction à cette angoisse, l'existant, à l'instar du cocher, peut agir de différentes manières : il peut tenter, grâce à sa volonté, de donner aux chevaux une direction particulière mais il peut aussi les laisser courir comme bon leur semble et abandonner toute volonté, tout désir de maîtrise. Un passage marquant :
« Comme le coursier ailé, l'éternité a une vitesse infinie ; la temporalité est une rosse [cheval sans vigueur], et l'existant est le cocher, bien entendu quand on ne prend pas le terme d'exister au sens banal ; car, dans ce cas, l'existant n'est pas un cocher, mais un paysan ivre qui se couche et s'endort dans la voiture en laissant les chevaux se tirer d'affaire. Lui aussi conduit, cela va de soit ; lui aussi est cocher ; et beaucoup peut-être existent ainsi. »
Pourquoi ai-je l'impression que ce passage sur le paysan ivre est particulièrement à propos ? Et pourquoi ai-je commencé à (re)lire de la philosophie dans un sens antichronologique ? Pourquoi ai-je commencé à lire Wittgenstein avant Kierkegaard ? Et pourquoi me procurerais-je Le concept de l'angoisse avant d'avoir lu Phèdre de Platon ? Si ça continue, je vais finir par m'intéresser à la grotte Chauvet.
Et Melancholia dans tout ça ? Deux chevaux noirs, terrestres, fougueux, difficiles à dompter, refusant de passer un pont... Un cheval noir que Justine la mélancolique n'arrive pas à diriger, même en usant de la pire violence... Un cheval noir qui refuse d'avancer... Est-ce une métaphore du manque de volonté de Justine, de son incapacité à faire autre chose que de se coucher et de s'endormir en lâchant complètement la bride ? Von Trier le Danois, lecteur attentif de Kierkegaard le Danois ? Cela semble tellement évident que ça me fait de la peine de ne pas m'en être rendu compte plus tôt.
________________________________
* C'est le cheval noir qui semble le plus sympathique. Normal que l'attelage soit difficilement contrôlable.
Histoires de "Q"
Non, ce titre n'est pas une tentative désespérée pour rameuter du monde sur ce blog délaissé par tous. Par tous ? Non ! Car une poignée d'irréductibles lecteurs résiste encore et toujours à la tentation de se casser en courant. Et la vie n'est pas facile pour ces derniers, tentant coûte que coûte de digérer les nombreuses salades sur Wittgenstein, l'Univers, la sérendipité et les bunkers... (Mille fois merci à eux.)
— Je ne suis pas d'accord ! Le rock, au contraire, est une musique qui évolue tout le temps. C'est même ce qui fait sa force et sa longévité !
— Le rock, c'est une musique qui déchire. Un gars qui prend sa guitare et qui en sort un son monstrueux, ça c'est du rock.
— Si on prend cette définition à la lettre, certains morceaux de Pink Floyd ou de King Crimson, une part du rock progressif et plus tard du post-rock ne rentrent pas dans la catégorie "rock". Pourtant, c'est du rock.
— Vraiment, pour moi, le rock, c'est un truc bien précis. Par exemple, seul le premier album de Radiohead [Pablo Honey] est un album de rock. Après, ce n'est plus vraiment du rock.
— M'enfin ! C'est un peu bête de réduire à ce point la définition, non ? Selon toi, pour que ce soit du rock, il faut qu'il y ait un rythme basique à quatre temps, un chanteur et une guitare ? »
Est-il nécessaire d'être aussi restrictif ? Ne vaut-il pas mieux considérer que toute musique vivante échappe à toute forme de définition cadrée et donc dire que : "Est rock tout ce qui est considéré par quelqu'un qui aime le rock comme étant du rock" ? Peu importe qu'on appelle cette musique du "rock", du "rock progressif" ou encore du "rock alternatif"... Le genre échappe à toute mise en boîte. La musique est comme un langage : elle ne nécessite pas de définition. Dit de cette manière, Jonas est plus ou moins d'accord... — Toute discussion sur des définitions est presque par essence stérile : on peut être d'accord sur le fond et en opposition sur la définition, ce qui est absurde.
« C'est un peu comme le jeu. Peut-on définir ce qu'est un jeu ?
(Wittgenstein revient au galop.)
— C'est quelque chose d'inutile, lance Léandra.
(Je redeviens énervant, là, non ?)
« C'est un peu comme l'amour. Peut-on définir ce qu'est l'amour ? »
En définitive, j'aurais mieux fait de ne pas la poser, cette question. J'aurais dû anticiper les réponses...
Éthique du bunker
« Des bombes atomiques vont bientôt pleuvoir sur toute la planète et tu es responsable d'un des nombreux bunkers qui abriteront les générations futures de l'humanité. Le problème est le suivant : le groupe dont tu as la charge est constitué de douze personnes (toi y compris) et le bunker n'est prévu que pour six locataires. Tu dois absolument choisir ceux qui entreront dans le bunker (qui seront sauvés) et ceux qui resteront dehors (qui mourront dans d'atroces souffrances). Ton choix ne sera en aucun cas remis en question. »
« Une femme au foyer enceinte- Une jeune policière- Un docteur en médecine de 40 ans- Une scientifique de haute volée de 30 ans- Un philosophe grisonnant- Un jeune électricien étranger- Un ouvrier non-qualifié de 45 ans- Une jeune chômeuse sans diplôme- Un vieux prêtre- Une adolescente de 15 ans- La maman de l'adolescente, institutrice »
À la récréation, après le cours, j'en rediscutai avec mon ami Laurent :
— Non, tu ne le ferais pas. C'est joli de dire ça mais dans la pratique, si tu en avais la possibilité, tu sauverais ton cul et puis c'est tout. C'est l'instinct de survie qui veut ça.
— Si tu le dis... On ne le saura sans doute jamais. »
Et je m'imaginais donc à l'extérieur du bunker, regardant sans rien dire les champignons nucléaires se former sur fond de ciel rougeoyant, avant d'être très rapidement désintégré par l'onde de choc thermique... Je ne sais si je serais capable d'une pareille chose, évidemment. Sans doute, comme Laurent me l'affirmait alors, que je m'enfuirais comme un lâche pour sauver ma peau... Sans doute que je prendrais place dans le bunker et que je terminerais ma triste vie de rescapé nucléaire avec le remords d'avoir laissé mourir une personne à ma place...
Hé, Hamilton, du calme, ce n'est qu'un exercice mental, hein !
Panique à la TEC
Est-ce un film banal ou un chef-d'œuvre ? Il me faudra le regarder une seconde fois pour rendre un avis définitif. En tout cas, en visionnant ce film, tard le soir, je suis en parfaite continuité avec la discussion d'hier sur le monde qui s'écroule.
Une heure de l'après-midi. J'ai achevé ma matinée de boulot et je suis dans un bus assez bondé qui se dirige vers la gare des Guillemins et le Centre-ville de Liège. Trois jeunes — ils doivent avoir entre 16 et 18 ans — abordent une jeune femme assise au milieu du véhicule. (Comme d'habitude, les conversations sont approximatives : il y a du monde et certains éléments m'ont été rapportés indirectement par les passagers du bus.)
C'est plus ou moins à ce moment qu'un autre passager du bus entre dans la danse. Il fonce sur l'impoli, l'empoigne et lui donne plusieurs coups de poing dans la figure en lui criant : "Connard ! Tu fais moins le malin quand t'as affaire à un homme, hein ?" ; l'autre se protège la tête de ses mains puis tente à son tour de donner des coups de poings. La rixe se transforme en pugilat pendant une vingtaine de longues secondes. Une dame, presque au bord des larmes, crie : "Vous voyez où elle nous mène, toute cette violence !" Plusieurs passagers hurlent au chauffeur : "Arrêtez le bus, arrêtez le bus !" Le bus s'arrête, les portes s'ouvrent et les trois jeunes s'en vont. Celui qui s'est pris quelques coups de poing dans la figure lance à son agresseur : "On se reverra, mec, on se reverra !" Puis le bus redémarre et tout le monde, forcément, parle de l'événement.
Je prends le train vers Namur, j'attends l'heure de la sortie des cours à la brasserie "Le Flandre", je récupère ma fille à l'école, nous attendons le train pendant une demi-heure dans le hall de la gare, Gaëlle joue au petit train, nous reprenons le train vers Bruxelles rempli jusqu'à ras bord, nous allons faire les courses, je nettoie mon appartement, je fais à manger. Quand Léandra sonne chez moi, vers 19h45, j'ai réussi à rendre l'appartement convenable et à préparer une partie de la nourriture, mais la vaisselle n'est pas finie et la table n'est pas encore entièrement dressée.
Je voulais leur faire des carbonnades flamandes, à mes invités de ce soir (Léandra et Jonas), mais c'est impossible puisqu'il y a dans la préparation de ce plat un élément incompressible : le temps de cuisson. Faut que ça cuise des heures entières, Madame, pour que ce soit bon... Et aucun de nous n'a envie de manger à dix heures du soir, vous comprenez ? C'est humain, ha ben oui. Y a comme un avant-goût de printemps aujourd'hui, vous ne trouvez pas ?
J'opte alors pour un rôti de bœuf sauce au poivre et une salade de pâtes. Pour la sauce au poivre, j'essaie un nouveau "truc" qui s'avère vraiment pas mal, qui consiste à faire infuser à feu doux des grains de poivre noir entiers dans de la crème fraîche, puis de filtrer cette dernière à l'aide d'une simple écumoire pour enlever les grains de la sauce. Ensuite, il faut mélanger le résultat obtenu avec des échalotes finement hachées préalablement cuites dans le jus de la viande avec quelques cuillerées de Porto et un soupçon d'Armagnac. Tout ce bordel pour deux décilitres de sauce au poivre : tout compte fait, j'aurais dû préparer des carbonnades...
Et voilà : à part deux noms d'auteurs de science-fiction, je n'ai rien noté de la soirée et, en conséquence, évidemment, je ne me souviens que de l'ambiance générale (c'était une chouette soirée) mais pas du contenu. C'est un peu décevant, non ?