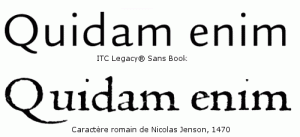« Les étoiles, on ne les désire pas ;
On ne peut que se réjouir de leur splendeur. »
(Goethe)
« (...) semblable à l'imperator romain qui, se vouant à la mort,
lançait son javelot dans les rangs ennemis, [le génie] jette ses
œuvres bien loin en avant sur la route où le temps seul
viendra plus tard les ramasser. »
(Schopenhauer)
Avertissement préliminaire : à l'exception de la dernière partie sur la formidable intelligence du poulpe, tous les chapitres de cet article constituent des notes personnelles qui me permettent de mieux comprendre ce que je viens de lire. Je décline d'avance toute responsabilité quant à l'éventuelle somnolence qu'ils engendreraient chez toute personne qui, nonobstant cet avertissement, déciderait de continuer la lecture au-delà du point qui ferme la présente phrase. <= Ce point-là.
Philosophie. — Je lis beaucoup en ce moment. De la philosophie surtout. En témoignent les deux colis Amazon qui m'attendent chez mes parents et qui contiennent, outre le cadeau d'anniversaire de ma fille (une Nintendo DS), quatre livres : Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, Du génie d'Arthur Schopenhauer, les Carnets secrets de Wittgenstein ainsi que la correspondance de celui-ci avec l'architecte Paul Engelmann. Si les trois derniers se lisent très facilement car j'avance si je puis dire en terrain connu, il n'en va pas de même pour les 700 pages bien tassées qui composent la Critique... Qu'à cela ne tienne ! Les « autres » ne cessent de citer cette somme en référence ou en opposition. Il est donc ridicule de ma part d'aller plus loin sans retourner à la source — à une des grandes sources en tout cas — de la philosophie moderne.
Un constat : mon besoin d'être autre part et dans un autre temps, qui jadis se concrétisait dans la science-fiction, s'est déplacé vers la philosophie. Est-ce un signe de maturité ou de vieillissement ?
Une précision : je ne fais que résumer (et parfois commenter) ce que j'ai compris de mes lectures d'aujourd'hui. Cela ne signifie en aucun cas que je suis d'accord avec ce qui est énoncé.
Kant. — Je me mets à lire avec attention les deux préfaces et l'introduction de la Critique de la raison pure (deuxième édition, 1787) sur fond de Bob l'éponge (sans doute est-ce une première dans l'histoire de l'humanité). Ça change : voilà donc un auteur qui prend le temps de poser son sujet, de déclarer ses objectifs et d'expliquer de manière extrêmement (voire trop ?) didactique, à l'aide de nombreux exemples et digressions, chacun des termes utilisés, chaque concept, un peu à la manière d'un professeur. Le texte est beaucoup plus facile d'accès que ceux de L.W. qui, pour sa part, répugne à dire et se contente de montrer : demandez à ce dernier si « Je pense donc je suis » est valide et il vous répondra quelque chose comme : « "Je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui" est-il valide ? » (ce qui, soit dit en passant, est une excellente réponse).
Dans ses préfaces, Kant annonce la couleur : son objectif est de mettre fin une bonne fois pour toutes aux querelles incessantes de son temps autour de la métaphysique (branche de la philosophie qui s'occupe des causes premières, qui a pour objet l'étude de ce qui dépasse les frontières du Monde) ; de s'assurer que cette dernière connaisse le même chemin jalonné (« la voie sûre d'une science ») que celui qui fut jadis parcouru par les mathématiques et la physique. Rien de moins !
Pour ce faire, écrit-il, il convient de mettre en place l'équivalent d'une « révolution copernicienne » : si nous voulons que la métaphysique fasse un bond en avant, il faut renverser le paradigme. Ainsi Kant propose-t-il, dans ce domaine, une nouvelle méthode d'investigation : plutôt que d'essayer de prendre appui, en vain, sur les différents objets affectant nos sens pour en tirer de pures intuitions, ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, régler ces objets d'après une connaissance établie a priori, précédant toute forme d'expérience ? La révolution proposée ici est donc la suivante : la connaissance devient le centre et c'est en quelque sorte à l'objet de tourner autour d'elle. L'utilité d'un tel bouleversement, explique-t-il, est à la fois négative et positive : négative car il restreindrait grandement les frontières à l'intérieur desquelles la métaphysique peut se développer ; positive car il permettrait enfin d'utiliser la métaphysique à des fins pratiques, autrement dit de faire ressortir son usage moral.
Dans son introduction, Kant distingue tout d'abord les connaissances a priori (indépendantes de l'expérience) de celles a posteriori (dépendantes de l'expérience). Au sein des premières, il ajoute une distinction et nomme « pures » les connaissances qui ne sont absolument pas liées à l'expérience. Ces connaissances pures sont par définition nécessaires et universelles (comme la notion d'espace et de temps), tandis que les connaissances a posteriori sont contingentes et locales (résultats d'une expérience dont l'issue aurait pu être autre).
D'après le philosophe, il existe au sein de notre connaissance du Monde des problèmes qui vont au-delà de toute expérience sensible et qui, malgré ce dépassement des frontières expérimentales, ne peuvent être considérés par l'humanité avec mépris, parce qu'ils touchent au sublime. Ces problèmes sont — roulement de tambour ! — « Dieu, la liberté et l'immortalité ». Sur ces sujets, libérés que nous sommes des contraintes de l'expérience, la tentation est grande de construire un édifice dont les fondations risquent fort d'être particulièrement branlantes. Pour tenter de résoudre le problème, Kant va injecter dans son explication deux autres concepts : les jugements analytiques et les jugements synthétiques.
Un jugement analytique (ou explicatif) ne fait que décomposer un sujet donné en une série d'attributs (le prédicat) qui étaient déjà contenus implicitement en lui (exemple cité par Kant : « tous les corps sont étendus », car l'idée de « corps » comprend en elle-même celle d'une extension de ce corps dans l'espace sans qu'il faille aller chercher l'explication autre part) ; un jugement synthétique (ou extensif) est au contraire un jugement dans lequel le lien entre le sujet et le prédicat ne peut être tiré de la simple analyse mais nécessite le recours à des ressources extérieures (c'est le cas de « tous les corps sont pesants » : pour le savoir, nous avons besoin de confronter les corps à l'expérience, qui mettra en avant le phénomène de pesanteur). L'idée de Kant est la suivante : alors que les jugements a posteriori (dépendants de l'expérience donc) sont tous synthétiques, les jugements a priori (indépendants de l'expérience) peuvent être non seulement analytiques, mais aussi, dans des cas très particuliers, synthétiques. Pour lui, toutes les mathématiques pures et une partie de la physique contiennent des jugements qui ne sont ni synthétiques a posteriori (car non dérivés de l'expérience), ni analytiques a priori (car non dérivés de la seule analyse). Ces jugements sont des jugements synthétiques a priori.
Compte tenu qu'il existe, d'après lui, de tels jugements au sein des mathématiques et de la physique, Kant considère que des connaissances synthétiques a priori doivent également parsemer la métaphysique. Le philosophe allemand en vient donc enfin — ouf ! —, après toutes ces explications, à exposer le problème principal contre lequel il bute : « Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? » La survivance de la métaphysique est conditionnée par la résolution de cette question ; son effondrement par la démonstration qu'il n'existe aucune solution. De là l'idée de Kant de créer une nouvelle science intitulée « critique de la raison pure », dont le principal objectif serait de clarifier ce domaine du savoir qui consiste à connaître quelque chose absolument a priori, c'est-à-dire absolument en dehors du monde de l'expérience et des objets sensibles. Il introduit alors le concept de connaissance transcendantale, qui s'intéresse à notre mode de connaissance des objets plutôt qu'aux objets eux-mêmes.
Lorsque j'aurai lu, compris et digéré la première subdivision de la première partie du livre sur « l'esthétique transcendantale » — l'espace et au temps —, j'en ferai un compte rendu ici-même. (Oui, je sais, ça promet.)
Schopenhauer. — Difficile pour Arthur de définir le génie sans tomber dans l'élitisme facile et l'autosatisfaction crasse. Dans les deux chapitres constituant le petit recueil Du génie, suppléments au tome III du Monde comme volonté et comme représentation (3e édition, 1859), il tente de définir le génie, ce talent donné à quelques uns de voir pleinement ce que les autres ne peuvent qu'esquisser avec beaucoup de difficulté — bande de moules qu'ils sont, va ! C'est hautain, méprisant à l'égard de « l'homme du commun », c'est misogyne, c'est du Schopenhauer !... Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine fascination pour cet homme et pour son œuvre. Est-ce grave, docteur ?
Dans « Du pur sujet de la connaissance », le philosophe explique sa vision de l'intellect, selon laquelle chaque être humain navigue entre deux pôles, deux extrêmes : le premier est celui de la volonté (le moi propre, ancré dans le monde et tourné vers la satisfaction des besoins personnels...), le second est celui de la conscience des autres choses (la connaissance objective, la pure intuition du monde extérieur...). Rien de neuf : il s'agit de l'ancienne dualité — le tiraillement — entre le monde terrestre (physique) et le monde céleste (idéal), que l'on retrouve déjà chez Platon. Pour Schopenhauer, plus on s'éloigne de la volonté et des passions, plus on se rapproche de l'idéal de perfection nécessaire à l'apparition du génie. Le génie est donc cette capacité de faire abstraction complète de sa propre volonté pour atteindre un état de pure objectivité grâce auquel l'essence du monde apparaît dans sa plus belle nudité (c'est toujours ça de pris — en matière de nudité, je veux dire).
Une phrase intéressante sur les conditions qui favorisent l'apparition de l'étincelle de génie : « Qu'on n'entende pas par là les boissons spiritueuses ou l'opium, mais bien plutôt une nuit entière d'un sommeil tranquille, un bain froid et tout ce qui, en calmant la circulation et la force des passions, donne à l'activité cérébrale une prédominance acquise sans effort. » Dommage que tonton Artie ne soit pas un peu plus prolixe sur la question et qu'il n'explique pas pourquoi il préfère un bon bain froid et une nuit de sommeil à une beuverie solitaire nocturne.
Il décrit alors une sensation bien connue (qu'il appellera notamment « œil du monde » et, au chapitre suivant, « miroir du monde ») : « [Ces stimulants naturels] détachent de plus en plus l'objet du sujet et finissent par produire cet état de pure objectivité de l'intuition, qui élimine de lui-même la volonté de la conscience, et dans lequel toutes choses apparaissent avec une clarté et une précision plus intenses ; nous ne connaissons pour ainsi dire alors que les choses, sans presque rien savoir de nous (...) », ou encore, un peu plus loin : « (...) toutes les choses gagnent en beauté à nos yeux, à mesure que la conscience extérieure s'accroît et que la conscience individuelle s'évanouit. » — Je comprends parfaitement ce qu'il veut dire par là, sans être génial pour autant (loin s'en faut) : les textes dont je suis le plus satisfait (pour autant que je puisse l'être) furent à coup sûr rédigés dans cet état-là, mais ce ne fut jamais après un bain froid ou un sommeil réparateur, mais plutôt après avoir beaucoup marché ou beaucoup bu.
Dans le chapitre suivant, intitulé « Du génie », Schopenhauer sépare le génie du simple talent de la manière suivante : « l'homme doué de talent possède plus de rapidité et plus de justesse dans la pensée que les autres ; le génie au contraire contemple un autre monde que le reste des hommes ». — Combien de fois n'ai-je pas dit à Léandra que telle personne de notre entourage était terriblement talentueuse mais gâchait tout son talent en essayant de s'adapter à tout prix à son système de référence ? (Cela devait, je pense, relever presque du même constat, sauf que dans le présent chapitre, il est sous-entendu que l'homme « simplement » talentueux ne pourra jamais s'élever au rang de génie.)
Schopenhauer entrevoit plusieurs catégories de génies : l'artiste (reproduisant fidèlement la nature qu'il contemple, à l'aide d'images), le poète (... à l'aide de mots) et le philosophe (... à l'aide de concepts abstraits). Tous ont en commun d'être inutiles (« les grands et beaux arbres ne portent pas de fruits »), c'est-à-dire de ne pas s'intéresser à l'aspect pragmatique, terrestre de l'existence. Rien d'étonnant par ailleurs à ce que Schopenhauer vénère et cite à tout bout de champ Goethe, car ce dernier avait la rare faculté d'être à la fois un artiste, un poète et un philosophe accompli.
La seconde partie du chapitre prend une tournure différente, parfois intéressante, parfois comique, parfois aussi complètement navrante (mais propre à son temps, sans aucun doute). Schopenhauer tente de déceler dans l'expression, le caractère, le mode de vie et la physionomie des individus les marques du commun (« le cachet de la trivialité » qui se dessine sur le visage, par exemple) et celles du génie. Parmi les caractéristiques du génie selon Schopenhauer, on retrouve ainsi (on respire un bon coup !) : le regard clair et pénétrant ; l'humeur sombre et mélancolique (car, entre autres, le génie aperçoit mieux que quiconque la misère de sa condition) ; une existence souvent malheureuse et dépourvue de richesse (car le génie place son sérieux non dans le quotidien mais dans la seule pure connaissance, dont il est l'interprète privilégié) ; l'intemporalité de sa pensée et la non reconnaissance de celle-ci par ses contemporains (raison pour laquelle le génie est fondamentalement un solitaire, qui cherche la compagnie de ses semblables dans les livres) ; la posture à contre-courant par rapport à son époque (alors qu'au contraire, la personne de talent y est particulièrement bien adaptée) ; la reconnaissance tardive, souvent bien après sa mort, de son œuvre ; l'excentricité, la folie, la violence, l'excitation, les émotions non maîtrisées, la colère, le manque de sang-froid, l'excessive sensibilité et la passion (alors que l'homme talentueux se montre posé, calme et sûr de lui dans la plupart des décisions qu'il prend) ; la fermeté au service d'un sujet ou d'une cause unique, de manière compulsive ; le caractère enfantin (« tout enfant est dans une certaine mesure un génie, et tout génie est en quelque façon un enfant ») ; la masculinité (« les femmes peuvent avoir un talent considérable, mais jamais de génie [sic] ») ; un bon estomac ; un cœur puissant, rapide et énergique ; un cerveau plus volumineux et plus lourd que la moyenne (!) ; un tissu cérébral d'une très grande finesse ; un front haut et un crâne bien arqué (!) ; une petite stature (mais pas toujours) et un petit cou. — Somme toute, ce que décrit avant tout Schopenhauer dans ces quelques pages, c'est son propre reflet !
(Mon actuel mal de tête est-il lié à mes tentatives désespérées de résumer ces pensées sans les trahir ou bien à l'absence complète d'alcool dans mes veines depuis quelques jours ?)
Les poulpes ont-ils du génie ? — Chouette émission télévisée que Thalassa, présentée par le sympathique et passionné Georges Pernoud. C'est un programme au long cours, qui laisse le temps au temps et que ma maman, passionnée par la mer, ne manquerait pour rien au monde. Ce soir, entre autres, un reportage intitulé « La planète des pieuvres » qui m'a profondément marqué. Schopenhauer a-t-il raison lorsqu'il affirme que les « animaux même intelligents reste[nt] insensibles à des choses frappantes en soi [comme] par exemple ne manifester aucune surprise à la suite de changements évidents survenus dans notre personne ou dans les objets qui les entourent » ? Pas sûr !
Je savais déjà que la pieuvre (ou poulpe) était un animal d'une très grande intelligence, étonnante pour un invertébré, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. La pieuvre est capable de développer des stratégies élaborées, tant pour fuir un prédateur que pour attraper une proie. Parmi ces stratégies, on notera la capacité de modifier intégralement la couleur de sa peau, soit pour effrayer, soit pour se camoufler. Ainsi, lorsqu'elle se camoufle, elle mémorise rapidement son entourage immédiat et modifie sa peau en conséquence. Elle est capable de réaliser pareille prouesse dans son environnement naturel mais aussi — et c'est là que ça devient vachement balèze ! — sur des motifs totalement inconnus, comme ce tapis aux formes géométriques présenté à l'animal lors d'une expérience.
Plus curieuse encore, cette expérience d'apprentissage : prenez deux pieuvres, l'une « candide » (qui ne connaît pas l'expérience), l'autre « expérimentée ». Mettez la candide dans un aquarium dans lequel est placé un autre aquarium plus petit contenant de la nourriture (un crabe), que l'on peut ouvrir grâce à trois ouvertures de nature différente. La candide voit le crabe mais ne semble pas s'y intéresser car il est emprisonné dans son aquarium, qu'elle juge hermétique. Ensuite, réitérez l'expérience avec la pieuvre expérimentée, en donnant l'occasion à la candide d'observer sans pouvoir agir. L'expérimentée se lance directement à l'assaut du petit aquarium contenant le crabe et l'ouvre en quelques secondes, pendant que la candide, désormais intéressée, se jette contre la paroi vitrée pour observer avec attention la manœuvre (!). Si vous recommencez l'expérience avec la candide après cet unique apprentissage visuel, celle-ci s'appliquera certainement à ouvrir le petit aquarium en deux temps trois mouvements !
Le reportage se termine sur ces poulpes qui, en Méditerranée, développent des comportements de groupe afin de lutter contre les prédateurs, particulièrement nombreux dans cet environnement. Ces animaux-là commencent à apprendre, à développer une culture basée sur la découverte et la transmission de nouveaux savoirs... Dans dix mille ans — qui sait ? — peut-être trouvera-t-on dans les eaux de la Mare nostrum une civilisation d'Octopus Sapiens ?