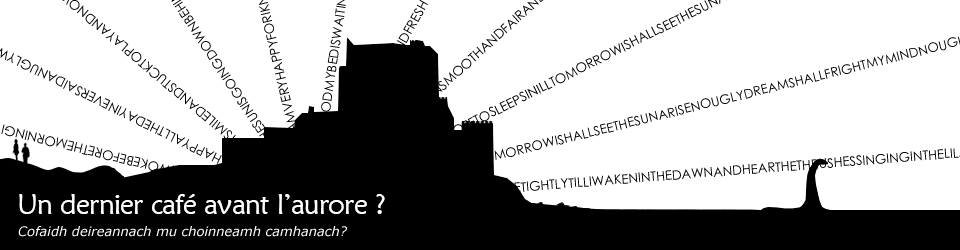
En soirée, je suis de retour à la maison familiale pour y passer la seconde semaine des vacances de Pâques en compagnie de ma fille Gaëlle. L'ambiance est pour le moins morose, pour ne pas dire malsaine. En plus, je suis toujours malade...
Je suis encore dans mon trip country/bluegrass : pour me réconforter, je passe une partie non négligeable de la nuit à écouter des musiciens jouer du banjo ou à regarder des extraits de films contenant... des morceaux de banjo. Ça vire, comme assez souvent avec moi, à l'obsession passagère. — Ce timbre si particulier ; ces pincements de cordes si caractéristiques, parfois légers, festifs et joyeux, parfois empreints d'une profonde mélancolie ; cette impressionnante vitesse d'exécution : j'adore — je vénère — le banjo ! Placez un seul de ces instruments dans un orchestre et je n'aurai plus d'oreilles que pour lui.
Il n'est pas rare d'entendre ou de voir des banjos au cinéma, surtout si le film est un western, un road movie ou encore une production se déroulant dans une région des États-Unis à l'héritage sudiste. Par exemple, le banjo fait une apparition très discrète mais néanmoins remarquable dans le formidable « Adieu à Cheyenne », morceau de la bande originale, signée Ennio Morricone, du film Il était une fois dans l'Ouest (1968). Dans un autre western spaghetti moins connu (et moins bon aussi) datant de la même époque, Sabata (1969), « Banjo » est le surnom d'un des personnages principaux, un tueur qui ne se sépare jamais de son instrument à quatre cordes, dans lequel est dissimulé... un fusil ! Et puis, il y aussi le très sympathique O Brother, Where Art Thou? (2000) des frères Coen, narrant les vicissitudes de trois prisonniers en cavale se faisant entre autres passer pour un groupe de bluegrass, un film dans lequel, forcément, le banjo est omniprésent.
La plus belle scène de banjo jamais tournée au cinéma est peut-être celle qui se manifeste au début de l'angoissant et somptueux Deliverance de John Boorman (1972), un film mettant en scène quatre habitants d'Atlanta qui veulent s'adonner, le temps d'un week-end, aux joies du retour à la nature sauvage, préservée de l'action des hommes : ils ont pour projet de descendre en canoë la tumultueuse rivière Cahulawassee, au nord de la Géorgie, avant que toute la vallée ne soit définitivement inondée à cause d'un barrage. Mais la virée écologiste tourne au cauchemar lorsque le groupe se fait traquer par deux habitants du cru, pervers et dégénérés. Un des citadins se fait violer au cours d'une séquence particulièrement glauque, devenue fameuse. Pour s'en sortir, ils sont obligés de tuer, puis d'échapper à cette nature hostile dont, confiants, ils vantaient les mérites en début de périple. — Ce film est tellement subtil, ironique, symbolique et bien construit qu'il mériterait un article à lui tout seul... Mais pas aujourd'hui, car aujourd'hui, nous parlons de banjos !
La scène du banjo est, tout comme celle du viol, devenue culte : les quatre citadins, condescendants et très sûrs d'eux, débarquent dans un hameau paumé au milieu de nulle part, où les habitants vivent en quasi-autarcie. Certains de ceux-ci semblent mentalement déficients et portent sur le visage les marques de la consanguinité. Le plus artiste des quatre amis, Drew Ballinger (l'acteur et guitariste Ronny Cox), accorde sa guitare adossé contre une voiture et se voit rapidement rejoint par un taciturne « garçon au banjo » : lui aussi semble mentalement déficient, et autiste, mais il est à tout le moins un virtuose du banjo. — Cette scène est un avant-goût de ce que les citadins vont devoir endurer dans leur aventure à venir : l'impossibilité d'établir une communication avec les villageois si ce n'est par des moyens détournés (ici, la musique) et l'infériorité complète de leur groupe face à cette nature vierge et ces habitants à la lisière de la civilisation : Drew restera constamment en contrebas de la terrasse où le jeune garçon joue ; son visage est filmé en plongée alors que celui du gamin est filmé en contre-plongée : tout un symbole ! (Le morceau joué ici, intitulé « Feudin' Banjos », a été composé par le musicien Arthur Smith en 1955.)