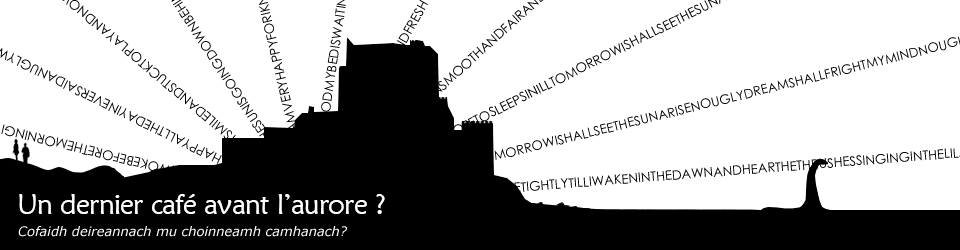C'était une très bonne idée, et aussi un vrai coup de cœur dès le survol de la quatrième de couverture, que d'acheter ce tout dernier essai de Jacques Bouveresse intitulé Le danseur et sa corde1 lors de la Foire du livre politique de Liège, le 8 novembre 2014, et ce malgré la promesse faite à moi seul de ne surtout pas y dépenser le moindre centime. (Car il faut bien voir la réalité en face : je suis ruiné ! Depuis des années, je ne comble momentanément le rouge de mon compte bancaire qu'en y insérant du crédit, c'est-à-dire, en résumé, en y ajoutant quelques ridicules zéros que je ne possède pas et que je ne posséderai sans doute jamais.) « Je n'ai pas perdu ma journée ! », m'avait alors lancé le gardien du stand2, « J'ai réussi à vendre un livre de Bouveresse ! » Lui aussi semble apprécier le personnage : « Êtes-vous au courant de ce grand moment au cours duquel il a refusé la Légion d'honneur ? » (Oui, je connaissais l'histoire et elle est effectivement assez jubilatoire3.) Mais pour être tout à fait exact, ce sympathique vendeur n'a pas réellement réussi à me vendre un livre de Bouveresse : je l'ai acheté sans lui. Il aurait essayé de me le vendre que j'aurais détalé à toutes jambes. Gloire soit rendue, en fin de compte, à l'absence complète de prosélytisme de sa part.
Quand Jacques Bouveresse écrit sur quelqu'un, je suis presque sûr que ce quelqu'un va m'intéresser. J'ai en ce moment, pour une raison qu'il faudrait peut-être un jour essayer de décortiquer, en grande partie les mêmes goûts que lui. Je l'ai découvert (et par la même occasion Jean-Jacques Rosat, Pascal Engel, etc.) à l'époque où, après avoir lu beaucoup de textes de Wittgenstein, je me suis mis à lire beaucoup de textes sur Wittgenstein. Alors que j'ai été complètement dérouté par certains de ceux-ci malgré leur qualité manifeste (comme Les voix de la raison de Stanley Cavell, dont je ne pense pas avoir compris grand-chose4), j'ai directement adhéré à la démarche de Bouveresse. Ses travaux m'ont permis de (re)découvrir et de mieux comprendre Wittgenstein, mais aussi Kraus, Musil, ainsi que d'autres auteurs qui, tous, partagent un certain air de famille (ils ont peut-être pour point commun de ne jamais être véritablement contents ni d'eux-mêmes, ni de leur production).
Le danseur et sa corde aborde un quasi inconnu pour moi : Gottfried Keller (1819-1890), romancier et poète suisse de langue allemande, auteur entre autres du roman partiellement autobiographique Henri le vert (Der grüne Heinrich, 1855 pour la première version, 1879-1880 pour la seconde). Les deux objectifs de Bouveresse dans cet essai sont de comprendre pourquoi Wittgenstein admirait à ce point Keller et aussi de préciser les rapports que le premier entretenait avec la religion, ces deux objectifs étant, malgré les apparences, assez liés. Comme souvent, Bouveresse s'autorise de nombreux détours par d'autres personnalités qui partagent d'une manière ou d'une autre un lien avec le thème principal : Tolstoï (dont l'Évangile a profondément marqué Wittgenstein), Nietzsche (auquel le titre de l'essai fait explicitement référence), mais aussi, assez curieusement (du moins de prime abord), le compositeur Johannes Brahms.
Au-delà des questions religieuses — comme celle de savoir ce qu'est une pratique religieuse honnête selon Tolstoï et Wittgenstein ; ou encore celle de comprendre la relation complexe et de plus en plus distante que Gottfried Keller a entretenue avec la religion, jusqu'à devenir un homme « dont l'irréligiosité ne consiste pas dans la négation de la transcendance, mais dans le refus de s'expliquer avec elle ou seulement de la rencontrer » (Bernd Breitenbruch)5 —, ce texte s'arrête à plusieurs reprises sur un sujet qui me touche énormément : la différence, parfois très importante, qui peut exister entre l'apparence extérieure d'une personne et sa production. Sur ce point, Keller est peut-être encore plus extraordinaire que Wittgenstein. Bouveresse reprend une description de Herman Hesse à son sujet : « Chez Gottfried Keller nous voyons s'arracher à une vie caractérisée par une gêne et une lésinerie considérables, à une vie de célibataire et de buveur de vin taillée sur un modèle trop petit, faite de lubies, de pauvreté, de bravades, une œuvre qui ne semble rien savoir des misères et des insatisfactions rentrées ; nous voyons l'homme, trop petit de taille et plongé dans une affliction profonde, atteindre dans l'œuvre une harmonie, une atmosphère de supériorité et de vision pure, un sacrifice du moi au profit de la beauté, qui ne ravit pas seulement mais, en tant qu'acte artistique, est exemplaire au plus haut degré, alors que pourtant la vie réelle semblait tellement être si peu exemplaire6. » Même si je ne suis pas un fanatique du style grandiloquent des dernières lignes (« vision pure », « sacrifice du moi », etc.), cette description d'un petit homme qui écrit de grandes choses — ou plutôt : qui est capable de transformer et de mettre en relief les éléments les plus insignifiants de sa vie — m'a tout de suite plu.
Le même constat vaut aussi pour Brahms, du moins pour celui « de la maturité » (l'expression est d'Albrecht Dümling), raison pour laquelle, sans doute, ce compositeur apparaît si souvent dans l'essai de Bouveresse : taciturne, réservé, fréquentant les auberges d'habitués (« Le Hérisson rouge », tout un programme !) où il ne nouait pas facilement contact, Brahms donne l'impression d'avoir eu, après sa jeunesse, une vie assez misérable, mais sa musique n'en porte pas la marque. En 1857, revenant apparemment sur les déclarations plus enflammées de ses jeunes années, il écrit à Clara Schumann (l'épouse de Robert, mort en 1856) : « Les passions n'appartiennent pas à l'homme comme une chose naturelle. Elles sont toujours une exception ou constituent des excès. Celui chez qui elles dépassent la mesure, celui-là doit se considérer comme un malade et prendre soin par la médecine de sa vie et de sa santé. Paisible dans la joie et paisible dans la douleur et le chagrin est l'homme beau et vrai. Les passions doivent s'en aller bientôt, ou bien il faut les chasser. »7 (C'est une maxime que je pourrais prendre pour moi en ce moment, et je ne sais franchement pas s'il faut que je m'en inquiète ou que je m'en réjouisse. En tout cas, je ne considère pas ce genre de déclaration comme une forme d'aigreur face à ce qui n'a pas réussi, mais plutôt comme une forme d'acceptation face à ce qui a raté.)
Pour terminer sur un épisode comique : dans cet essai, Bouveresse prend le temps de raconter la brève rencontre qui a eu lieu entre Gottfried Keller et Nietzsche, le 30 septembre 1884. Nietzsche avait une très haute estime de Keller, au point de lui envoyer ses livres et de le considérer dans une lettre « comme le seul poète allemand vivant ». Keller, quant à lui, cultivait semble-t-il une certaine méfiance pour le mégalomane à moustache. Le pianiste Robert Freund, qui a eu la chance de connaître les deux, a raconté après coup ce que l'un et l'autre ont pensé de l'entretien. Nietzsche aurait trouvé la rencontre sympathique, mais aurait par contre été épouvanté par « l'allemand abominable que parlait Keller et la façon très pénible dont le grand écrivain s'exprimait oralement ». Keller aurait été un peu plus bref : « Je crois que le gars est fou. »8
Je n'en ai pas fini avec ce texte de Bouveresse. À suivre, donc ! (Et quand je dis que c'est à suivre, cette fois-ci, j'en suis certain !)
________________________________________
1 Jacques Bouveresse, Le danseur et sa corde. Wittgenstein, Tolstoï, Nietzsche, Gottfried Keller & les difficultés de la foi, Marseille, Agone, 2014.
2 Le site Web de cette librairie indépendante (la librairie Entre-Temps de l'asbl Barricade, installée en Pierreuse, à Liège) vaut la peine d'être consulté : www.entre-temps.be. Une des ambitions de mon interlocuteur est d'un jour arriver à inviter Jacques Bouveresse à un débat à Liège. Qui sait ? Peut-être est-ce un rêve à portée de main ?
3 La lettre, envoyée à Valérie Pécresse en pleine ère Sarkozy, contenait notamment ce réjouissant morceau de bravoure : « Il ne peut [...] être question en aucun cas pour moi d’accepter la distinction qui m’est proposée et – vous me pardonnerez, je l’espère, de vous le dire avec franchise – certainement encore moins d’un gouvernement comme celui auquel vous appartenez, dont tout me sépare radicalement et dont la politique adoptée à l’égard de l’Éducation nationale et de la question des services publics en général me semble particulièrement inacceptable. » (Le texte complet se trouve sur cette page des éditions Agone.)
4 Stanley Cavell, Les voix de la raison : Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la tragédie, Paris, Le Seuil, 2012 (traduction de Sandra Laugier et Nicole Balso). En lisant ce livre, j'ai rencontré des murs d'incompréhension que je ne me sentais pas en mesure de franchir et, alors que j'essayais de mieux comprendre Wittgenstein via un de ses commentateurs les plus connus, je l'ai en quelque sorte encore moins compris ! Soit dit en passant, je ne me suis pas laissé abattre et j'ai abordé l'œuvre de Cavell par une autre porte d'entrée, à savoir ce qu'il a écrit sur Emerson et Thoreau.
5 Cité par J. Bouveresse, op. cit., p. 192.
6 Ibidem, p. 52-53.
7 Ibidem, p. 55-57 (p. 56 pour la citation).
8 Ibidem, p. 94-95.