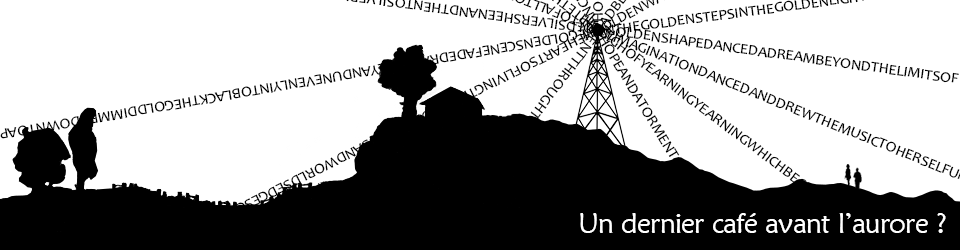________________________________________________________________
Titre original : "No, No, Not Rogov!"
Série : Les Seigneurs de l’Instrumentalité (The Rediscovery of Man)
Traduction : Simone Hilling
Première parution : anglais : If, février 1959 ; français : Pocket, 1987.
________________________________________________________________
"La forme dorée sur les marches d’or tremblait et voltigeait comme un oiseau devenu fou – comme un oiseau doué d’un intellect et d’une âme, et pourtant poussé à la folie par des extases et des terreurs au-delà de l’humaine compréhension – des extases incarnées momentanément dans la réalité par l’exécution d’un art superlatif."
Ainsi commence la première nouvelle de la saga dite des "Seigneurs de l’Instrumentalité" ; non pas la première par ordre de parution, mais la première si l’on se réfère, de manière fort logique, à la chronologie délibérément floue de l’univers de Cordwainer Smith, qui s’étale de 1942 après Jésus-Christ jusqu'à un lointain futur, plus de dix mille ans plus tard. C’est là un début poétique qui exprime à la perfection le plus fantastique des nombreux talents de ce conteur hors pair : celui d’accrocher le lecteur dès le premier paragraphe, dès la première phrase, dès les premiers mots...
En détails
(Préambule) Dans un lointain futur (l’équivalent de l’an 13582 après J.-C.), l’humanité remporte le concours du Festival de Danse Inter-Mondes, grâce à l’interprétation magistrale d’une danse intitulée "La Gloire et l’Affirmation de l’Homme".
(Chapitres 1 et 2) En Union soviétique, en 1947, Staline initie dans le plus grand secret le Projet Téléscope et le confie à deux des meilleurs scientifiques russes du moment : Nikolai Rogov et son épouse Anastasia Fiodorovna Cherpas. Le projet est mené dans un village oublié et transformé en territoire militaire. Les deux chercheurs sont constamment entourés et espionnés par deux agents à la solde du régime : Gausgofer, une fanatique amoureuse de Rogov, et Gauck, un homme sans aucune passion.
(Chapitre 3) Le but du Projet Téléscope est de mettre en place une technologie dont les fonctions consistent 1) à recevoir et interpréter les pensées d’un cerveau humain [aspect récepteur] ; 2) à influencer, paralyser voire détruire les processus de pensées dudit cerveau [aspect émetteur]. Son fonctionnement : une aiguille chirurgicale est insérée méticuleusement au niveau d’un nerf (optique, auditif...) ou directement dans le crâne pour toucher le cerveau. En cas de réussite, l’URSS aurait un avantage considérable sur le Bloc occidental. Vers 1954, la petite équipe scientifique, travaillant sur l’aspect "émetteur", parvient à provoquer des hallucinations collectives et une vague de suicides dans le village voisin. Travaillant ensuite sur l’aspect "récepteur", Rogov et Cherpas obtiennent des résultats encourageant, comme la captation d’un dîner familial dans une ville voisine.
(Chapitre 4) Après avoir longtemps expérimenté la technique de l’aiguille dans le cerveau d’animaux puis sur des prisonniers, les deux scientifiques sont en mesure de capter des esprits situés à de très grandes distances. En mai de la mort d’Eristratov (?), ils décident de tester le récepteur sur leur propre cerveau. Rogov, l’inventeur du projet, teste la machine en premier. Il croyait traverser de grandes distances en esprit, mais son invention fonctionne trop bien : en plus de traverser l’espace, son cerveau traverse également le temps et se retrouve directement connecté avec ce que l’humanité a peut-être produit de plus puissant : l’interprétation magistrale d’une danseuse lors d’un concours de l’an 13582 après Jésus-Christ (décrite dans le préambule).
(Chapitre 5) Après cette expérience, le cerveau de Rogov, désorienté par tant de beauté, est à jamais perdu dans cet autre temps. L’affaire se répercute en haut lieu, entraînant l’arrivée sur le théâtre de l’expérience d’un ministre-délégué du nom de V. Karper et de sa "cour".
(Chapitre 6) Gausgofer, l’agent soviétique, tente de rejoindre Rogov en réitérant l’expérience de l’aiguille mais se tuera dans la tentative : transportée elle aussi en l’an 13582, elle devient folle, se lève d’un bond et se fait déchirer le cerveau par l’aiguille plantée dans son crâne. Pendant l’expérience, Cherpas, à l’écoute grâce à deux aiguilles plantées dans son nerf auditif, a compris où se trouvait son mari et que ce dernier ne reviendra jamais. Elle arrive à convaincre les autres que, sans Rogov, le Projet Téléscope est enterré. Elle sanglote à plusieurs reprises les mots : "Non, non, pas Rogov !".
(Épilogue) Retour à la danseuse, qui termine son spectacle et qui redevient une simple humaine, abandonnée à elle-même après tant d’effort, sous les applaudissements d’un millier de monde.
Commentaires
Cette courte nouvelle est une très jolie variante sur le thème du voyage dans le temps. Elle est également un moyen pour l'auteur d'avancer quelques réflexions assez subtiles sur le rôle de la science, sur le côté impalpable de la beauté artistique et sur le fonctionnement du cerveau...
1) Une histoire "en deux temps" : c'est la construction-même de l'histoire qui rend ce texte si attachant, si touchant. De prime abord, le lecteur ne comprend absolument pas ce que vient faire cette danseuse d'un lointain futur dans une nouvelle qui traite en grande partie de recherche militaire en URSS. En mettant en opposition, d'une part, un spectacle d'une beauté à couper le souffle qui dépasse la raison et, d'autre part, une équipe de scientifiques à l'esprit justement très carré et rationnel, l'auteur arrive à créer un choc émotionnel durable. À la fin de l'histoire, Rogov se rend compte à quel point son esprit pourtant supérieur, mathématique, plein d'ironie est vain face à une beauté fulgurante venue des étoiles. C'est un thème récurrent dans l'œuvre de Cordwainer Smith : la confrontation d'une humanité passionnée à la froide technologie, l'opposition art/science.
2) Aléas et débordements de la recherche scientifique : dans cette nouvelle, le voyage dans le temps est découvert par hasard par des scientifiques très doués mais qui ne comprennent pas toujours avec quoi ils "jouent". Dans ce cas-ci, les deux chercheurs soviétiques n'ont absolument pas pour mission de découvrir un quelconque moyen de voyager dans le futur. Leur objectif s'inscrit dans le cadre très prosaïque de la Guerre froide : il s'agit surtout de "gagner la bataille" contre les Occidentaux grâce à une technologie d'avant-garde. "Non, non, pas Rogov !" constitue dès lors une merveilleuse démonstration du côté parfois aléatoire de la recherche scientifique (de nombreuses découvertes fondamentales ont été le fruit du hasard le plus complet) ainsi que son côté non circonscrit : en jouant avec des outils qui les dépassent largement, les scientifiques se brûlent parfois les doigts.
3) Un déplacement temporel cérébral : il n'est pas ici question de déplacement physique dans le temps ni dans l'espace, seulement d'un déplacement de l'esprit. Physiquement, le sujet de l'expérience est là ; mentalement, il se trouve autre part. Dans le cas de Rogov, il est apparemment piégé dans cet "autre part" à jamais (l'équivalent d'un très mauvais trip). Cette thématique est à rapprocher du roman La Maison sur le rivage (The House on the Strand, 1969), de Daphne du Maurier, dans lequel le narrateur expérimente une drogue qui lui donne la possibilité de remonter le temps mentalement, et plus particulièrement de suivre, en spectateur, les pérégrinations d'un couple du XIVe siècle, avec certains dangers. La nouvelle rappelle aussi – ou, plus exactement, précède –, mais de manière plus lointaine, La Jetée (1962), fantastique moyen métrage de Chris Marker qui a donné lieu des années plus tard à L'Armée des douze singes, plus long et moins bon. Dans ce "film", le protagoniste se déplace réellement physiquement dans le temps, mais la place donnée aux souvenirs, l'utilisation du cerveau ainsi que la poésie et l'humanité de l'ensemble permettent un certain rapprochement avec la nouvelle de Cordwainer Smith.