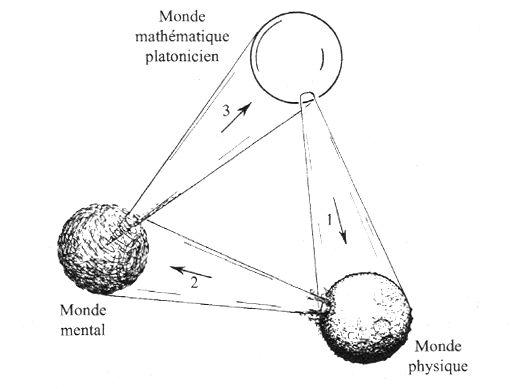Me situer par rapport à des tests de personnalité — en l'occurrence ceux hérités de la typologie jungienne, comme le MBTI® — ne me pose aucune difficulté. Je suis un cas d'école, un modèle idéal : je déteste les demi-teintes, les demi-mesures ; je suis pour ainsi dire « sans surprise » et je peux facilement être mis dans de jolies petites cases bien nettes (en fait, j'aime bien être mis dans de jolies petites cases bien nettes). Ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, confrontée à ce genre de test, ma collègue Wynka est du genre à constamment tergiverser. À chaque question posée, elle répondra presque systématiquement (je l'ai déjà observée) : « Ça dépend des jours, ça dépend des situations. Parfois je me comporte comme ceci, mais parfois je me comporte comme cela. Parfois j'aime être comme ceci, mais parfois c'est l'inverse. » Avec une personnalité comme la sienne, trouver un profil approchant est plus délicat, car il faudra prendre le temps de déterminer l'attitude préférée — de quel côté penche la balance — en posant une kyrielle de questions. On pourrait dire de Wynka qu'elle est résistante aux tests de personnalité ; que, contrairement à moi, elle ne se laisse pas enfermer dans un moule réducteur (et c'est tout à son honneur).
On pourrait dire aussi que ces tests sont une belle sottise pseudo-scientifique qui permet tout au plus de définir un certain nombre de cas de figure (mais pas tous) dans une société donnée (la société occidentale au sens large). Est-il seulement possible d'établir une sorte de « taxinomie » de l'état psychologique sur des bases aussi simples ? Et aussi : pourquoi à chaque fois proposer de choisir entre deux dimensions possibles (introverti-extraverti, etc.) et pas sept ou dix-neuf ou cent cinquante-huit ? Mais l'objet de ce texte n'est pas d'être critique : c'est de comprendre comment tout cela fonctionne. La critique viendra peut-être plus tard, dans un autre article.
Pour me familiariser avec la typologie jungienne telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, je suis en train de lire, en plus du livre de Penrose et de mon manuel d'arabe donc — ou : comment se disperser encore un peu plus —, un petit ouvrage sur les types de personnalité signé Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux1. C'est le genre de manuel qui peut être utilisé par le personnel du département des ressources humaines d'une entreprise ou bien par cette relativement nouvelle catégorie d'individus nuisibles que l'on appelle « coachs ». Le livre s'attache plus particulièrement au MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) et au CCTI® (Cailloux-Cauvin Type indicator), qui compartimentent la population en seize catégories distinctes. La définition d'une catégorie passe en gros par la résolution de quatre questions : 1) est-ce que l'attitude (disposition à agir dans une certaine direction) de la personne analysée est plutôt portée vers l'extraversion ou l'introversion ? 2) est-ce que sa fonction de perception (la façon dont elle recueille l'information) est sensitive ou intuitive ? 3) est-ce que sa fonction de jugement (la façon dont elle évalue l'information recueillie) est basée sur la pensée (jugement objectif) ou sur le sentiment (jugement subjectif) ? 4) enfin, est-ce que sa préférence est dirigée vers la perception (attitude réactive face à la vie) ou vers le jugement (attitude proactive) ? — Il y a également moyen de procéder autrement au sein du même cadre, en délimitant quatre fonctions dites « orientées » qui définissent quatre pôles de personnalité, du pôle préféré (la fonction dominante) au pôle le plus inconscient (la fonction inférieure). Cet aspect-là ne sera pas abordé dans cet article, d'autant plus qu'il est possible de retrouver directement ces quatre fonctions à partir des seize types de personnalité proposés.
J'ai joué le jeu : je me suis amusé à lire attentivement ce qui caractérisait telle ou telle dimension de la personnalité selon le MBTI® et à trouver, avec la plus grande honnêteté, ce qui me correspondait le mieux. Comme on le verra dans les paragraphes ci-dessous, il n'y a pas vraiment de préférence floue : la balance penche à chaque fois presque entièrement d'un seul côté. C'est la raison pour laquelle j'écrivais plus haut que je suis un cas d'école.
Extraversion (E) ou introversion (I) ? — À la première question qui est de savoir si je suis un extraverti (E) ou un introverti (I), autrement dit si je puise mon énergie dans le monde extérieur ou en moi-même, la réponse me paraît terriblement évidente : je suis un introverti. La plupart de mes actes trahissent une préférence très marquée pour l'introversion, voire pour le solipsisme quand je suis « en grande forme ». On trouvera notamment comme indices évidents : que je trouve la solitude très épanouissante (mes plus grands moments de bonheur, à l'exception de quelques-uns, d'ordre sexuel pour la plupart, ont eu lieu alors que j'étais seul — on en revient à cette histoire de bonheur endogène) ; que j'adore lire ; que j'aime les espaces confinés où je peux me sentir en confiance (seul ou avec quelques amis triés sur le volet) ; que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'écriture (une activité lente, qui prend le temps de la réflexion) qu'avec la parole (une activité immédiate, directe, qui ne permet pas les retours en arrière) ; que je n'aime pas dépendre des autres (demander de l'aide à quelqu'un est un vrai supplice) ; que j'adore l'indépendance ; que je navigue aisément sur le flot de mes pensées, mais que je suis beaucoup moins bon pour comprendre (ou plutôt sentir) celles de mes proches ; etc. Certaines descriptions du livre de Cauvin et Cailloux sont très amusantes, car elles me rappellent des situations vécues au quotidien depuis l'enfance : « [...] un extraverti répondra immédiatement à la question posée, alors que l'introverti prendra le temps de la réflexion, ce qui amènera l'extraverti à reposer sa question, croyant que l'introverti ne l'a pas entendue, puisqu'il n'a pas répondu »2. (Le dernier « De toute façon, tu n'écoutes jamais » remonte à hier. C'est ma mère qui me l'a lancé. C'est d'autant plus énervant que c'est plutôt le contraire qui se passe : ce n'est pas que je n'écoute jamais rien, c'est que j'écoute toujours tout ce qu'il faut écouter, mais il faudrait apparemment que je réponde « oui » ou « d'accord » à chaque fois qu'une parole qui m'est plus ou moins destinée arrive jusqu'à mes oreilles).
Sensation (S) ou intuition (N) ? — « Entre les arbres et la forêt, sensoriel et intuitif ont choisi leur camp. Le premier connaît tous les arbres. [...] Le second porte en lui l'image de la forêt. » Puis, un peu plus loin dans le texte : « Le sensoriel aime le concret. [...] L'intuitif aime ce qui émerge mais n'est pas encore. »3 Faut-il développer plus avant ? Ce que je suis, si l'on prend pour base cette typologie, saute aux yeux : je suis un intuitif. J'aime l'induction, les plans d'ensemble, les grandes théories et les systèmes englobants. J'adore la science-fiction et la prospective. Les détails m'ennuient et je déteste l'idée de séquence intermédiaire ou de procédures linéaires. Je suis toujours en train de faire plein de choses en même temps, dans ce que mon entourage considère souvent comme un désordre apparent, dépourvu de toute méthode. Pourtant, je m'y retrouve très bien et je ne suis jamais dépassé (rien n'est grave) : comme un arbre, je possède tout simplement plusieurs branches qui poussent simultanément. En outre, je comprends souvent les choses d'un coup, sans vraiment passer par les mots : ces derniers ne viennent que bien après, parfois laborieusement, quand il s'agit d'expliquer à d'autres personnes pourquoi c'est comme ça. J'ai déjà mentionné le mécanisme de l'intuition dans mon journal, par exemple en date du 25 janvier 2013 : « "Oh, tu peux être certaine que c'est de cette manière que ça s'est passé !" Et voilà que nous nous mettions alors à reconstituer la façon dont une série d'événements et de prises de décision s'étaient sans doute déroulés, et ce, à partir de quelques éléments disparates, quelques indices considérés comme significatifs par d'inconnus processus cognitifs inconscients. Aucune preuve, aucune démonstration, juste un "c'est comme ça" difficile à expliquer. »
Pensée (T) ou sentiment (F) ? — La question est ici de savoir comment je traite les informations. La personne chez qui la dimension « Pensée » domine est plutôt du genre « penseur froid », qui analyse chaque situation de l'extérieur, de manière impersonnelle, avec la plus grande objectivité possible. Ce sont les « mentats » dans Dune de Frank Herbert : toute information (y compris d'ordre personnel) est bonne à prendre et est traitée, cataloguée, rangée au sein d'un ensemble plus large d'autres faits/concepts souvent reliés et en perpétuel mouvement. « Elric le Peseur », donc on retrouvera une description ici, est un excellent exemple réel — presque un absolu ! — de ce type de personnalité. À l'inverse, la personne de type « Sentiment » fait appel à ses convictions et s'implique personnellement dans le traitement de l'information : c'est Judith ! (Voir son blog et, de manière générale, tout ce qu'elle fait/dit : elle aussi est « presque un absolu » !) Cela ne signifie pas que le « T » est un robot sans aucune empathie (même le mentat Thufir Hawat peut se faire déborder par l'émotion et par la haine), ni que le « F » est une sorte de petite boule émotive qui pleure à chaque fois qu'un malheur arrive jusqu'à ses sens. « Pour le "T", ce qui ne va pas saute aux yeux et doit être dit tel quel ; la louange viendra ensuite, éventuellement. Pour le "F", l'appréciation positive est première ; les défauts ne sont signalés ensuite que si le climat permettant de les dire sans vexer a été établi. »4 — À nouveau, je n'ai aucun mal à me situer par rapport à ces deux dimensions : je suis de type « T ». Il suffit par exemple de voir comment j'ai réussi à offusquer des centaines et des centaines de personnes (parents, professeurs, amis, inconnus !) depuis ma plus tendre enfance, en déclarant quelque chose qui me semblait être seulement de l'ordre de la logique et de la vérité, mais qui a été pris comme une attaque personnelle. S'il fallait enfoncer le clou, je citerais l'article « Ablation du sentiment amoureux par chirurgie laser » (voir ici), que j'ai écrit alors que j'essayais de me défaire d'un coup de foudre raté. Ce texte, à lui seul, me présente dans un moment où je ressens beaucoup trop d'émotions indomptables (et donc beaucoup trop d'instabilité) et où je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir « à la normale » : une pensée froide, beaucoup plus stable, non soumise à des sentiments qui perturbent le jugement. La plupart du temps, j'essaye d'analyser mes émotions comme quelque chose d'extérieur à moi-même, comme si j'analysais n'importe quel autre objet extérieur. Donc : je suis de type « T ». Un cas d'école, encore une fois, ou presque.
Perception (P) ou jugement (J) ? — Ici, il est question de savoir comment je me me situe par rapport au monde extérieur. Est-ce que je préfère la perception ou le jugement ? La personne de type « P » est plutôt du genre flexible, ne prévoit rien à l'avance, préfère voir devant lui un arbre des possibles, alors que le « J » est organisé, ordonné et aime planifier. « Le "J" aime l'ordre, le classement, le rangement. Regardez sa table de travail : les objets usuels sont à la place qui lui a semblé la plus appropriée, toujours la même pour permettre facilement la saisie. Pas de papier superflu ; une corbeille de courrier, une feuille de papier blanc ; dans l'idéal, une table vierge et des dossiers bien classés. Pour lui, "à esprit clair, bureau en ordre". [...] Le "P" aime la profusion, le jaillissement, le choc des idées. Regardez sa table de travail ; les dossiers s'empilent, se chevauchent. Un océan de papiers la recouvre ; il est souvent à la recherche de ses lunettes, de son stylo, d'une gomme qui gisent, abandonnés dans quelque coin imprévu. [...] Pour le "P", "à bureau vide, esprit vide". »5 — Ici, c'est encore plus facile de choisir mon camp : je suis un « P », évidemment (mes collègues confirmeront). Les auteurs donnent un exemple flagrant des différences d'apprentissage entre un « J » et un « P » : à l'école, le premier fait ses devoirs dès qu'il les reçoit tandis que le deuxième attend toujours le dernier moment (il ne travaille bien que sous la pression). Tout mon parcours scolaire témoigne que je suis à mettre dans la deuxième catégorie. L'exemple extrême est celui de mes années d'université, durant lesquelles je n'ai jamais connu la moindre situation de « blocus » : en session d'examen, j'étudiais la plupart du temps mes cours la veille (ce qui m'a d'ailleurs donné de nombreuses sueurs froides, ainsi que beaucoup de nuits blanches... et aussi des résultats médiocres). Ma petite-cousine Chelsea, qui a brillamment réussi sa première année à l'université (c'est-à-dire en arrachant sans problème la plus grande distinction), est typiquement du genre « J ». Elle a étudié pendant la majeure partie de l'année et elle étudie déjà pour ses cours de l'année prochaine. Elle prend de l'avance (!), ce qui, à mes yeux, semble complètement incroyable : de l'avance sur quoi ? « Mon bureau est toujours très bien rangé. Est-ce grave ? », m'a-t-elle demandé un jour. J'aurais pu lui répondre : « Non, tu es simplement une "J" ».
INTP. — En ce qui me concerne, le mélange donne « INTP » : le genre « architecte », « philosophe » ou « penseur profond », qui cherche constamment de nouvelles manières de voir, qui peut aller très loin dans une réflexion qui lui semble prolifique et qui tend à classer, mettre de l'ordre, comprendre et relier chaque information reçue. Le genre solitaire aussi. Les INTP sont des perfectionnistes et des radicaux : il faut corriger à tout prix les erreurs jusqu'à ce que le résultat soit précis et satisfaisant. Pour un INTP, la connaissance est intéressante pour elle-même et non pour son résultat : élaborer un plan est plus valorisant que de construire une maison ; apprendre quelque chose de nouveau est intéressant en tant que tel parce que l'on apprend... quelque chose de nouveau (on en revient au concept d'autotélie décrit ici). Par ailleurs, « plus les problèmes à traiter sont complexes, plus les INTP sont heureux »6 (ha !). Un INTP a aussi beaucoup de mal avec les règles absurdes et ne reconnaît une personne que sur base de sa compétence et non de sa position hiérarchique (cela se voit notamment dans la manière d'éduquer un enfant, en lui laissant beaucoup de liberté). Dans les excès du type, on trouve : l'ennui quand quelqu'un ne comprend pas immédiatement quelque chose (ha-ha !) et la difficulté de travailler en groupe (re-ha-ha !). Et il y aussi cette phrase : « Ils sont peu à l'aise avec leurs propres sentiments, qu'ils manifestent rarement. En revanche, il peut arriver que ces sentiments surgissent avec violence, sous la forme d'un "coup de foudre" par exemple. »7 En une phrase : c'est moi tout craché. Ça fait peur. Mon comportement est-il si prévisible ? Existe-t-il des millions de gens qui réagissent de la même façon que moi ? Mais alors, où se cachent-ils ?
Je viens de me rendre compte d'une chose : il est possible que la plupart des psychologues qui trouvent intéressant de réfléchir à ce genre de typologie soient eux-mêmes à mettre dans la case « INTP » ou « INTJ » (INTJ étant l'autre type de penseur perfectionniste, qui est pour sa part satisfait quand sa pensée est mise en application : médecin, programmeur...). De la même manière, je ne m'intéresserais pas à ce genre de question si je n'étais pas ce que je suis. C'est peut-être pour cela que je rentre entièrement dans un type bien défini : parce que j'aime bien l'idée même de type, de classement mental. À voir la masse de forums et de sites Web qui traitent d'INTP ou d'INTJ, comparée à la masse d'informations beaucoup plus éparse concernant les autres types psychologiques, il semblerait que les individus qui savent qu'ils sont (ou qui se considèrent comme étant) des INTP ou des INTJ trouvent beaucoup plus important de se considérer comme tels et d'en parler. C'est le serpent qui se mord la queue : peut-être aurait-il mieux valu ne pas catégoriser seize types et seulement rester « entre nous » — entre catalogueurs compulsifs — en laissant le reste du monde tranquille avec ces absurdités réductrices ?
________________________________________
1 Pierre Cauvin et Geneviève Cailloux, Les types de personnalité. Les comprendre et les utiliser avec le CCTI® et le MBTI®, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 1994.
2 Ibidem, p. 18.
3 Ibidem, p. 24-25.
4 Ibidem, p. 32.
5 Ibidem, p. 37-38.
6 Ibidem, p. 108.
7 Ibidem, p. 109.