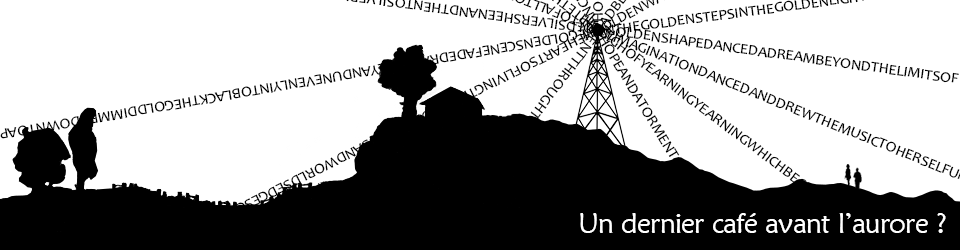« Je me trouve dans un de ces jours durant lesquels, sans raison, "le réel suinte". J'ai l'impression de réintégrer momentanément le giron de l'humanité. Je suis vivant. Je pourrais m'émerveiller devant, au hasard, quelque chose d'aussi banal (du moins en apparence) qu'un bourdon butinant une fleur ou bien la trajectoire d'un groupe d'oiseaux dans le ciel. J'ai le (faux) sentiment de tout comprendre, beaucoup plus rapidement que d'habitude, et je souris béatement dans le tram qui me ramène chez moi. (Je dois passer pour un taré.) » (Hamilton's Diary, 24 avril 2012.)
Je me souviens encore très bien du contexte dans lequel j'ai écrit ce paragraphe : au retour du travail, après avoir passé mon trajet ferroviaire à observer le paysage défiler (il y avait des oiseaux dans le ciel, mais pas de bourdon). Je me suis précipité sur mon ordinateur et j'ai écrit ce petit texte, sans réfléchir, parce que je sais directement reconnaître ce genre de moment durant lequel, sans raison, « tout coule », tout se fait sans le moindre effort. Cela n'a pas duré une journée, malgré ce que je sous-entendais alors : cela n'a duré que quelques heures. (La suite du texte, rédigée à un autre moment — le lendemain sans doute — est d'ailleurs particulièrement insipide.) J'ai déjà réussi à garder cette « humeur » beaucoup plus longtemps (une nuit entière parfois), mais cela demande un autre contexte, une autre activité que de regarder un paysage qui défile.
Je viens d'apprendre dans un best-seller un peu neuneu sur l'intelligence émotionnelle1 que cet état d'esprit particulier a été étudié dans les années 1980-1990 par un psychologue hongrois, Mihaly Csikszentmihalyi, qui lui a donné le nom de « flow ». Le terme est particulièrement bien choisi : il est simple et exprime clairement cette sensation d'être porté par un courant, de ne faire qu'un avec la tâche que l'on accomplit alors. M.C. caractérise le flow par une série d'indices, dont entre autres une sensation de contrôle total de l'environnement, une perte de la conscience de soi, une capacité de concentration beaucoup plus aiguë que d'habitude, une très grande clarté quant à ce qu'il convient de faire, une distorsion du temps... Schopenhauer traitait sans doute de la même chose lorsqu'il mentionnait cet « état de pure objectivité de l'intuition, qui élimine de lui-même la volonté de la conscience, et dans lequel toutes choses apparaissent avec une clarté et une précision plus intenses ; nous ne connaissons pour ainsi dire alors que les choses, sans presque rien savoir de nous. » (Voir ici.)
Certaines personnes arriveraient plus facilement que d'autres à un état de flow : celles qui possèdent des traits de caractère comme la curiosité et la persévérance, ou qui s'adonnent à une tâche pour son côté intrinsèque, sans autre but que la tâche elle-même (ce que M.C. appelle une activité autotélique, c'est-à-dire une activité dont l'objectif est l'activité elle-même). Rien d'étonnant que la chose soit assez courante chez moi : je suis un exemple vivant de personne qui trouve son plaisir et son bonheur dans l'activité en tant que telle, sans jamais chercher une quelconque utilité à ce que je fais (je déteste me rendre bêtement utile) : si j'apprends quelque chose, c'est dans le but d'apprendre ; si j'écris, c'est dans le but d'écrire. D'ailleurs, à ce jour, sauf erreur, ce blog n'a toujours pas de lecteur ; il fait le bruit de l'arbre qui tombe dans la forêt mais que personne n'entend (à l'exception du bûcheron)... et je ne m'en porte pas plus mal.
Je me souviens de ces quelques livres avalés en un temps record ; de ces nuits où, passionné et extrêmement concentré sur les pages que je tournais à vive allure, je digérais sans difficulté toute la trame d'un roman (le meilleur exemple reste Dune, dont j'ai lu les deux derniers tiers en une nuit, en début d'adolescence ; c'est pour cette raison que ce livre m'a terriblement marqué : je l'ai littéralement dévoré, et il m'a transformé comme aucun autre livre à ce jour). Je me souviens également de ces soirées complètes à écrire, entouré d'un même air de musique répété en boucle pendant des heures (la répétition aide à la concentration), imprégné d'un dédain complet envers le temps qui passe et les conséquences de mon acte : oui, il est cinq heures du matin et je devrai « me lever » dans une heure, et alors ? Si j'écris dans cet état, je n'ai plus besoin de réfléchir à la « bonne » tournure de phrase : la « bonne » tournure vient d'elle-même (le texte « Archéologie » a sans doute été entièrement écrit de cette façon).
Au cinéma, une des meilleures illustrations de ce que peut être le flow est la scène finale d'Unforgiven : cette nuit d'orage où le vieux tueur rouillé William Munny (Clint Eastwood) débarque dans le saloon et retrouve ses réflexes d'antan, tuant froidement, avec une lenteur incroyablement calculée, tous ceux qui braquent une arme sur lui... Comme si tout coulait de source. Dans un autre registre, il y a la scène du sac en plastique dans American Beauty. Un autre exemple, plus comique, issu du monde du dessin animé, est la scène des cent cafés dans Futurama : arrivé à ce nombre improbable de cafés bus en une seule journée, Fry passe d'un état d'énervement extrême à un état de calme parfait, de temps suspendu. Alors seulement, il comprend tout, il sait ce qu'il doit faire et il sait qu'il peut le faire : évacuer complètement une salle en feu, puis éteindre l'incendie (la chose est impossible dans la réalité, évidemment, mais la scène montre avec beaucoup d'humour en quoi consiste un de ces moments de « plus grande compréhension »). En musique, il y a la chanson « Runaway » de The National (cette mélodie est un courant). En philosophie, il y a Nietzsche (lire Ainsi Parlait Zarathoustra, qui semble avoir été écrit dans un état second). Et aussi Walden de Thoreau, bien que je ne sache pas vraiment dire pourquoi.
________________________________________
1 Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle, tome 1, Paris, Éditions J'ai lu, 2010. (Ce matin, Lodewijk, ayant vu ce livre posé sur un coin de mon bureau, a éclaté de rire et s'est exclamé : « Toi ! Toi, tu lis ça ? Eh bien tu n'es pas à une contradiction près ! » Ma collègue Sylvette, qui était elle aussi dans mon bureau à ce moment-là, lui a répondu, l'air incrédule : « Et c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte ? »)