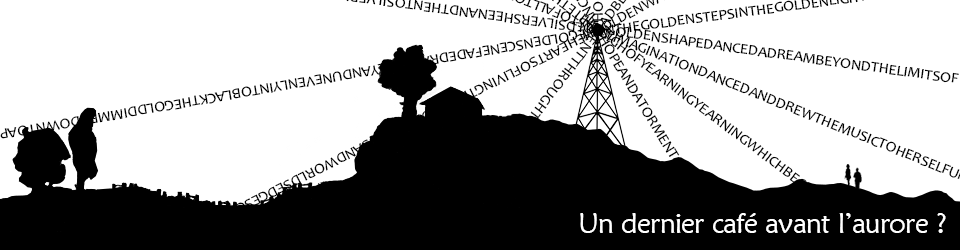« (...) "On peut faire ce qu'on veut, se dit l'Homme sans qualités en haussant les épaules, dans cet imbroglio de forces, cela n'a aucune importance !" Il se détourna, comme un homme qui a dû apprendre à renoncer, presque comme un malade que tout contact brutal effraie ; et quand, traversant le cabinet de toilette contigu, il passa devant un punching-ball qui y était suspendu, il lui donna un coup d'une rapidité et d'une violence telles qu'on n'en voit guère dans une humeur résignée ou dans un état de faiblesse. » (p. 36.)
« (...) Un beau jour, en tempête, un besoin vous envahit : descendre ! sauter du train ! Nostalgie d'être arrêté, de ne pas se développer, de rester immobile ou de revenir au point qui précédait le mauvais embranchement ! (...) » (p. 61.)
« (...) Quand on possède une règle à calcul et que quelqu'un vient à vous avec de grands sentiments ou de grandes déclarations, on lui dit : Un instant, je vous prie, nous allons commencer par calculer les marges d'erreurs et la valeur probable de tout cela ! (...) » (p. 67-68.)
Nous nous installons sous les arbres, à proximité de la petite piscine pour enfants du lac de Bambois. Après avoir été tartinée de crème solaire, ma fille court vers l'eau en quelques bonds enthousiastes et rapides. Elle ne tarde pas à y trouver une compagne de jeu à qui elle dictera ses désirs de scénarios alambiqués (nettoyer continuellement l'esplanade faite de planches en bois à l'aide de l'eau sale de la piscine, quelle idée !). — Après avoir longuement réfléchi sur l'incongruité d'une telle situation, ma mère se met en maillot de bain et va rejoindre Gaëlle au bord de l'eau. — Quant à moi, je reste tout habillé et me couche sur un long siège pliant, à l'ombre. Et je ne bouge plus. C'est que, depuis ce matin, je suis plongé dans un roman captivant, un des chefs-d'œuvre littéraire du XXe siècle paraît-il (mais je m'en fous pas mal de ce qu'il paraît) : L'homme sans qualités de l'Autrichien Robert Musil, traduit par Philippe Jaccottet (la traduction est une merveille, elle aussi).
« (...) Mais voici peut-être qui est mieux dit : l'homme doué de l'ordinaire sens des réalités ressemble à un poisson qui cherche à happer l'hameçon et ne voit pas la ligne, alors que l'homme doué de ce sens des réalités que l'on peut aussi nommer sens des possibilités traîne une ligne dans l'eau sans du tout savoir s'il y a une amorce au bout. À une extraordinaire indifférence pour la vie qui va mordre à l'hameçon correspond chez lui le danger de sombrer dans une activité toute spleenétique. (...) » (p. 42.)
Partout autour de moi, de la chair, féminine et masculine, jeune et vieille. Il y en a de trop et de toutes sortes, à tel point que ça en devient dégoûtant. Dès que je quitte mon livre des yeux, et ce quelle que soit la direction que prend mon regard, j'ai l'aperçu fugace de raies de fesses et de gros seins qui ballottent. Et entre les nombreuses rondeurs, des nymphes au corps parfait grillent au soleil. — Ce qui, dans un autre environnement, aurait pu passer pour excitant n'a strictement plus aucun charme : l'absence d'intimité et la quantité élevée de peau clairement affichée le long de cette plage ensoleillée enlèvent toute grâce au tableau. (Au loin, sur une des berges, un joli visage se distingue, sans que je ne sache pourquoi, des centaines d'autres.)
« (...) Il est vrai qu'on rencontre à chaque époque toute espèce de visages ; mais, à chaque fois, le goût du jour en distingue un dont il fera le visage du bonheur et de la beauté, et tous les autres visages, désormais, s'efforceront de lui ressembler ; même les plus laids s'en approchent, avec l'aide de la mode et des coiffeurs ; et seuls n'y parviennent jamais, nés pour d'étranges succès, ces visages en qui s'exprime sans concession l'idéal de beauté royal, mais évincé, d'une époque antérieure. Ces visages passent comme les cadavres d'anciens désirs dans la grande irréalité du commerce amoureux, et chez les hommes qui contemplaient bouche bée le vaste ennui des chants de Léontine sans comprendre ce qui leur arrivait, les ailes du nez étaient agitées de tout autres sentiments que devant les hardies chanteuses à coiffure tango. (...) » (p. 47-48. C'est moi qui souligne.)
Lisant le premier paragraphe — où il est question entre autres de la météorologie estivale de l'Europe et de la configuration classique des anneaux de Saturne (bref, « une belle journée d'août 1913 » des plus anodines) —, je sais que je vais adorer ce très long texte virtuose. Dans dix ans, si je suis encore en vie, lorsqu'on me demandera quels livres m'ont marqué dès les premières lignes, je pourrai mentionner, en faisant pour la forme l'impasse sur Goethe et sur les récents Wittgentein et Nietzsche : « Dune de Herbert, Hypérion de Simmons et L'homme sans qualités de Musil » ! — Voilà ce que je me dis aujourd'hui mais peut-être n'est-ce pas du tout vrai ? (Ou en tout cas, peut-être est-ce une belle simplification, comme à chaque fois qu'on demande à un être humain d'établir une liste ?)
« (...) Et Ulrich sentait que les hommes ignoraient cela, qu'ils n'avaient même aucune idée de la façon dont on peut penser ; si on leur apprenait à penser autrement, ils vivraient aussi autrement. » (p. 72.)
Ces intellectuels qui ont grandi et ont été éduqués à Vienne au carrefour des XIXe et XXe siècles semblent, vus depuis ce début de XXIe siècle — fade et pourri intellectuellement ; où aucune idée nouvelle ne voit le jour, faut-il encore le préciser ? —, avoir une conception beaucoup plus sévère et inflexible de ce que sont l'écriture et le travail personnels. On y trouve constamment cette idée de réforme de la pensée et du comportement. Un foisonnement de concepts sur la morale, la politique et la société ; une cité grecque très tardive, qui sera avalée par les guerres... Et nous serons nous aussi avalés par les guerres — à moins que nous ne le soyons déjà ? —, mais sans avoir développé une telle rigueur dans la pensée.
Vivre une époque médiocre en tout, sans talent, sans apogée... C'est la vie !