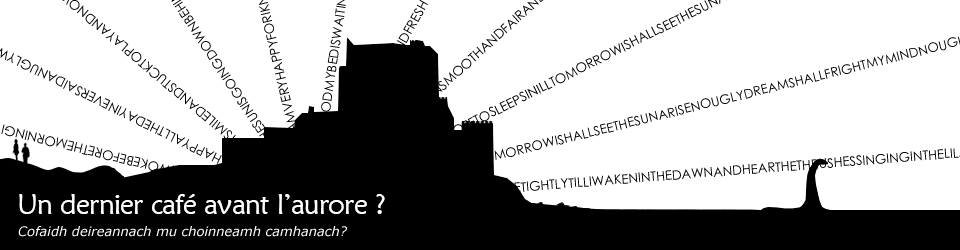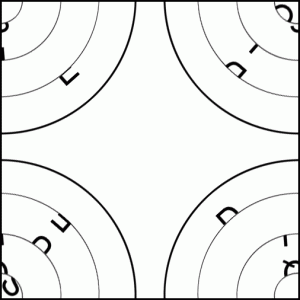Hermine
Les beautés féminines immortalisées dans les peintures de la Renaissance — ces jeunes femmes à la peau diaphane, à la fermeté tranquille et à la timide assurance qui ont servi de modèles à Filippo Lippi, Léonard de Vinci ou encore Raphaël, pour ne citer que ces trois-là — ne sont plus que poussière aujourd'hui. Compte tenu de l'intervalle de temps qui me sépare de leur jeunesse, elles auraient pu vivre et mourir dix fois d'affilée sans que j'aie la moindre chance de croiser un jour leur regard. C'est un constat évident et banal, qui me vient néanmoins très souvent à l'esprit lorsque je contemple une peinture de cette époque-là, et ce d'autant plus facilement que la femme qui sert de modèle au maître est un archétype de beauté, de grâce et de jeunesse. — Lorsqu'on est sensible à ce genre de pensée (une pensée qui appartient beaucoup plus au domaine de l'émotion brute et incontrôlable qu'à celui de la raison), il n'y a seulement, à mon sens, que deux façons de réagir : soit en pleurant à chaudes larmes, mais sans réelle tristesse (ces lignes sont très personnelles et je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre de qui que ce soit, mais qu'importe !) ; soit à la manière d'un Goethe ou d'un Schopenhauer, ce dernier étant d'une grande aide en la matière. Plutôt que de se lamenter sur le côté fugace, éphémère et périssable de toute beauté humaine et de toute vie (j'ai pris pour exemple la beauté féminine tout comme j'aurais pu mettre en avant l'entendement d'un génie, tout aussi périssable), un autre point de vue est possible : ce qui a disparu avec la mort d'une modèle, ce n'est pas la beauté en général, mais sa beauté à elle. La beauté, en tant que forme, en tant qu'idéal, n'a en rien disparu : elle se répète de génération en génération depuis très longtemps ; elle change seulement d'enveloppe, au sens purement matériel du terme (aucun mysticisme dans ce que j'écris). — Ce genre de raisonnement peut s'avérer intéressant lorsqu'on l'applique à soi-même, au-delà de ce concept de beauté qui est, somme toute, très annexe. C'est, je pense, une des plus belles répliques à la peur que nous développons envers l'idée de notre propre mort. Il est particulièrement difficile d'imaginer que la seule parcelle d'existence dont nous disposons sera un jour réduite à néant, parce que nous n'avons jamais connu que cette parcelle d'existence-là ; parce que ce que nous percevons est tout ce que nous avons. Et pourtant, notre mort ne sera qu'un des phénomènes les plus périphériques et les plus insignifiants de ce monde, qui parviendra très bien à exister sans notre présence. Cette pensée peut paraître insupportable parce que nous ne pouvons faire autrement que d'imaginer, parfois avec un véritable effroi, notre propre néant ; mais elle devient presque acceptable si nous retournons le paradigme : l'individu (notre individu) meurt, mais la forme humaine générale persiste, au sein de l'humanité. (Mais... Mais... Dans plusieurs milliards d'années, voire sans doute bien avant, l'humanité toute entière ne sera plus que poussière et, par conséquent, son essence même sera définitivement morte ! — En ce qui concerne cette pensée-là, il n'existe pas de solution aussi facile que l'idée de « sauvegarde éphémère de la forme » : si je pense l'humanité sur le très long terme, je me rends compte que nous sommes complètement perdus et, dès lors, aussi, que tout est vain, pensée très étrange si je la compare avec l'importance que je peux donner à certaines manifestations très précises de la beauté dans l'art.)
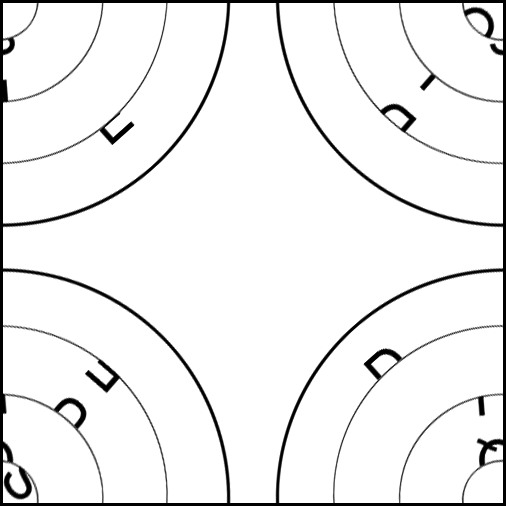
Le Devinoscope II
Riches heures
« (...) Le miracle d'hier est devenu aujourd'hui une évidence, et à partir de cet instant la terre entière bat, si l'on peut dire, d'un seul cœur. Les hommes, qui s'entendent, se voient, se comprennent, vivent à présent au même rythme d'une extrémité à l'autre de la terre, devenus, à l'image de Dieu, omniprésents grâce à leur propre force créatrice. Et l'humanité serait merveilleusement unie à jamais, grâce à sa victoire sur l'espace et le temps, si elle ne se laissait troubler sans cesse par l'idée folle et funeste de détruire cette unité grandiose et d'utiliser précisément les moyens qui lui confèrent la puissance sur les éléments pour s'anéantir elle-même. »
(Stefan Zweig, « Le premier mot qui traversa l'océan »,
Les Très Riches Heures de l'humanité, 1927 pour l'édition originale.)
Copier-coller
Anti-assertivité
Lex Leandrae
Nerfs
Quid novi? Leandra cattum habet!
« Petit chat,
Gentil petit chat,
Auras-tu la gentillesse de ne pas me croquer ?
Auras-tu la sagesse de ne pas me manger ?
Pourrai-je vivre en paix dans ma petite cage,
Sans craindre les assauts de ton instinct sauvage ?Petit canari,
Gentil petit canari,
Le lion s'interroge-t-il lorsqu'il chasse la gazelle ?
Un félin se soucie-t-il du contenu de sa gamelle ?
Prie pour que chaque jour soit synonyme de croquettes ;
Prie pour éviter, de mes griffes, la mortelle pichenette ! »(Hector-Antonin Serin, Les canaris :
mille et un poèmes pour enfants, 1918.)
Quid. — Léandra a désormais un petit chat chez elle et je dois absolument le voir, sous peine d'excommunication. Mon entourage commence d'ailleurs à se poser des questions : « Comment ? Tu n'as pas encore vu Quid ? » ; « Tu n'as toujours pas caressé son jeune poil soyeux ? » ; « Tu ne l'as jamais vu se démener sur son arbre à chat ? » ; « Te rends-tu compte, Hamilton, que ce chat est très intelligent ? Il est intrigué par son reflet ! Par son reflet, bordel ! Te rends-tu compte de ce que cela signifie, Hamilton ? Par son reflet, nom de dieu ! » — Aujourd'hui, le grand jour est enfin arrivé : Léandra m'a invité chez elle afin que je puisse rendre hommage à Sa Majesté des Chatons. Je ne me suis pas gavé d'antihistaminique, mais il paraît que l'allergie est moins forte au contact d'un jeune chat... Puisse la rumeur s'avérer exacte ! — Arrivé chez Léandra, c'est le choc : je tombe immédiatement sous le charme du félin et je ne peux plus détacher mes yeux de son petit corps plein de vie et de grâce. Je passe mon temps à jouer avec lui, à me faire gentiment griffer et mordre... Gentiment, oui, car ce chat est tellement sympathique qu'il rentre ses griffes lorsqu'il tente d'attraper ma main et ne resserre pas ses mâchoires lorsqu'il place l'un de mes doigts entre ses crocs. « Ce chat est un génie ! », s'exclame Léandra qui, pourtant, ne croit pas au génie. — (En me relisant, je suis bien content que Quid ne soit pas une femelle, auquel cas mon article aurait presque pu paraître obscène auprès de certains esprits particulièrement mal tournés.)