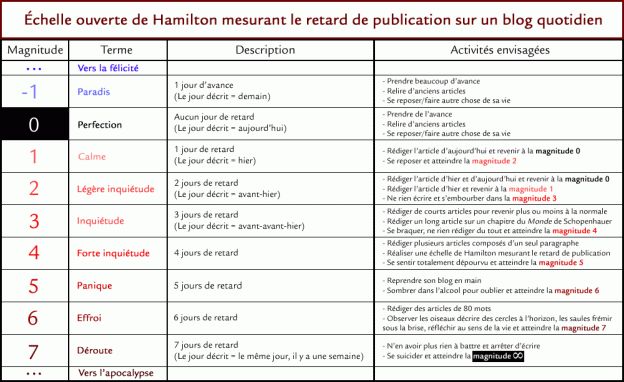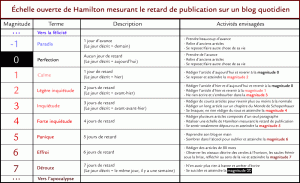Le périple autoroutier. — Gaëlle et moi sommes invités, en fin d'après-midi, chez Donna et Fred Jr, à trente-cinq kilomètres environ de la maison familiale. Malgré ce que l'on pourrait appeler au bas mot les « péripéties parentales » (dont il faudra absolument que j'écrive l'histoire noir sur blanc un jour prochain), rien ne change : ma mère refuse que Gaëlle et moi prenions le train ; pour elle, il est évident qu'elle va nous y conduire en voiture, accompagnée par mon père qui, assis à la place du mort, lui servira de copilote.
L'arrivée. — À peine sommes-nous arrivés chez Fred que Gaëlle, Anouchka et Mado se précipitent sur le trampoline pour enfants installé dans le jardin. Elles se mettent à bondir en rigolant ; elles font des cumulets* ; elles se tiennent par la main pour faire une ronde ; etc. Pendant qu'elles s'amusent tranquillement, je discute avec Fred, qui tente avec succès d'allumer le barbecue. On parle du cas « Derrick » et de l'affaire « Trullemans ». — Car y a-t-il en ce moment dans le monde, mon cher Monsieur, des sujets plus sérieux, plus importants, plus graves que le cas « Derrick » ou que l'affaire « Trullemans » ? Pauvre Allemagne, pauvre Belgique ! Mais où va-t-on ?
Le technique de cuisson. — Fred a une façon très particulière de cuire la viande au barbecue. Il pose cinq saucisses ou brochettes sur le grill et, dès qu'apparaissent les premières hautes flammes provoquées par la graisse chaude tombant sur les braises rougeoyantes, il réserve les morceaux de viande dans un saladier et les remplace par cinq autres morceaux. Cela demande une concentration et une dextérité de tous les instants. Je m'inquiète : cette activité ne risque-t-elle pas de perturber notre fabuleuse discussion sur le cas « Derrick » et sur l'affaire « Trullemans » ? Le suspense est insoutenable.
L'éducation. — J'ai déjà remarqué, et ce sans poser le moindre jugement de valeur, qu'Anouchka et Mado n'étaient pas du tout éduquées de la même manière que Gaëlle. Sans doute dois-je souvent passer, aux yeux de Donna, pour un père dangereusement permissif, voire complètement inconscient ! — Exemples : il ne me viendrait pas à l'idée d'imposer à ma fille de terminer à tout prix son assiette lors d'un repas, ni de mettre en place des horaires rigides de jeu, de télévision, etc. — Ma façon de concevoir l'éducation est en fait directement héritée de celle que j'ai reçue au sein d'une famille qui, globalement, considérait très tôt les enfants comme des interlocuteurs dignes d'intérêt, sur un pied d'égalité avec les adultes, sans imposition d'une hiérarchie et d'une règle comportementale stricte.
Le juron. — Gaëlle se fait mal en tombant d'un vélo et lâche, sans réfléchir : « Aïe ! Putain ! » Un peu plus tard, alors qu'elle joue à nouveau, seule cette fois-ci, sur le trampoline, je lui explique que ce n'est pas bien de prononcer ce genre de juron. Si je lui dis cela, ce n'est pas parce que je trouve que c'est mal de jurer dans l'absolu, mais plutôt parce que je trouve que c'est mal de jurer dans cet environnement-ci. Elle ne comprend pas, évidemment, et se perd dans des justifications sans fin alors que ce n'est nullement nécessaire : « Si j'ai dit cela, Papa, c'est parce que j'ai vraiment eu très mal ! »
Le juron. — Gaëlle se fait mal en tombant d'un vélo et lâche, sans réfléchir : « Aïe ! Putain ! » Un peu plus tard, alors qu'elle joue à nouveau, seule cette fois-ci, sur le trampoline, je lui explique que ce n'est pas bien de prononcer ce genre de juron. Si je lui dis cela, ce n'est pas parce que je trouve que c'est mal de jurer dans l'absolu, mais plutôt parce que je trouve que c'est mal de jurer dans cet environnement-ci. Elle ne comprend pas, évidemment, et se perd dans des justifications sans fin alors que ce n'est nullement nécessaire : « Si j'ai dit cela, Papa, c'est parce que j'ai vraiment eu très mal ! »
Le jeu. — Donna aime la compétition et les jeux de stratégie, contrairement à Fred, qui n'est pas particulièrement intéressé par ce monde-là. Avec elle, je joue à Okiya, un nouveau petit jeu d'alignement de tuiles japonaises signé Bruno Cathala. C'est à la fois simple et subtil. Donna gagne quatre parties sur les six que nous jouons et, si je remporte la dernière manche, c'est simplement parce qu'elle est trop pressée de gagner.
________________________________________
* Je viens d'apprendre à l'instant que le terme « cumulet » n'est pas utilisé dans toute la francophonie : c'est un belgicisme, synonyme de culbute ou de roulade. « Cumulet » est tellement courant en Belgique qu'il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il pouvait s'agir d'un régionalisme. (Un doute s'installe : tout ce que j'écris ne fleure-t-il pas le régionalisme pimpant ?)