Et en plus, il aime bien la bière spéciale et le bon vin !
Ça m'fait quelque chose de magique !
Et en plus, il aime bien la bière spéciale et le bon vin !
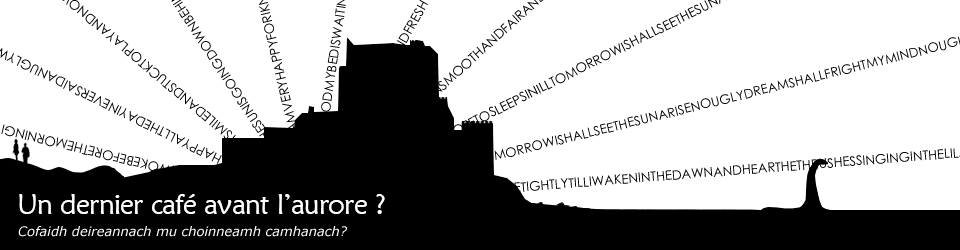
Rédaction. — Grève des chemins de fer ce mercredi : je travaille chez moi. « Chez moi », comme tout le monde le sait, ce n'est pas mon appartement silencieux mais un café bruyant du Parvis de Saint-Gilles, dont il n'est plus nécessaire de citer le nom.
De tous les syndicalistes que nous avons interviewés au cours de ces cinq derniers mois, celui-ci est sans doute le plus impressionnant... L'entretien se déroule presque par hasard : Charlotte le contacte ce matin par téléphone pour lui poser une question et voilà qu'il se pointe l'après-midi en personne pour y répondre ! Je propose d'assister au début de l'interview puis de retourner travailler à mon texte, mais — parce que je trouve le propos plus intéressant que toutes les deadlines du monde — je reste jusqu'au bout. À plusieurs reprises, je me dis que c'est une véritable aubaine que ceci soit enregistré, et aussi qu'il accepte la diffusion de toute l'information divulguée sans aucune restriction...
La personne devant le microphone fut, dans les années 1980, le président d'une ancienne délégation ouvrière très combative. Quand je l'entends parler de stratégies syndicales, je me rends une nouvelle fois compte que le syndicalisme n'est pas un simple jeu de pouvoir sans conséquence, mais une véritable guerre... « Au départ, rien n'est jamais prévu. Il faut conquérir ! »
La « boîte » dans laquelle il travaillait était le siège belge d'une multinationale américaine spécialisée dans les bandes magnétiques et le matériel informatique. Une des premières du genre. Le genre aussi à ne pas trop aimer les regroupements de travailleurs autour d'un syndicat, socialiste de surcroît. En conséquence, dès que notre homme fut élu délégué syndical, la direction de l'entreprise voulut l'évincer. Et ce fut la guerre ouverte.
Il nous explique : « Quand je suis arrivé, il y avait une certaine mentalité parmi les employés de l'entreprise : "Les ouvriers, c'est des manuels, c'est des cons... Les intellos, c'est nous, les employés ! Alors vous, les petits ouvriers, s'il vous plaît, ne dérangez pas les grands !" » Quelques années plus tard, les « cons manuels » reprennent la main : ils nouent de nombreux contacts avec des syndicalistes étrangers, organisent des assemblées générales durant lesquelles ils analysent méticuleusement les chiffres de la société au niveau international (commandes, prévisions, budget...) et en tirent une série de conclusions ou de perspectives sur la stratégie de l'entreprise et la manière de la contrer : « Les multinationales se basent sur un réseau tentaculaire pour élaborer une tactique sur le plan mondial. Il faut faire de même au niveau syndical ! »
Face aux menaces de restructuration, de licenciements et de délocalisation, notre syndicaliste nous explique avoir mis en place de multiples stratégies, qui s'avèrent d'une rare intelligence. Le but poursuivi : prendre constamment la direction à rebrousse-poil, faire exactement le contraire de ce qu'elle pense qu'ils vont faire. Une des tactiques fréquemment utilisées est celle, non pas de la grève, mais du ralentissement de la production (grève dite « perlée »)... Il donne pour consigne aux ouvriers des chaînes de montage de perdre certaines de leurs habitudes professionnelles et d'apprendre d'autres gestes techniques, afin de travailler plus lentement. Plus tard, il leur demande de suivre les manuels d'utilisation des machines de manière absolue, de respecter les procédures à la lettre. Une autre fois encore, il ne ralentit ou ne bloque qu'une partie de la chaîne afin de créer un goulet d'étranglement. Un jour enfin, pour forcer la direction à signer une convention collective, il monte de toutes pièces sa propre éviction : il fait croire aux patrons qu'une révolte ouvrière l'a destitué de ses fonctions de délégué principal... pour revenir une fois la convention signée !
Cet homme réfléchit et agit à la manière d'un guérillero dont l'arme la plus meurtrière est l'information : « Nous savions qu'ils avaient mis le local syndical sur écoute. Nous travaillions dans une grande multinationale américaine, donc nous étions forcément écoutés ! Alors, nous faisions deux réunions : l'une à l'extérieur et l'autre dans le local, où nous disions exactement l'inverse de ce que nous allions réellement faire. Parfois, nous retrouvions dans la bouche d'un cadre de la direction des morceaux de discours que nous avions tenus précédemment et nous avions la confirmation que nous étions sur écoute ! » Lors d'une occupation durant laquelle ils se retrouvent seuls dans l'usine, ils décident d'arracher une partie des murs du local syndical et de démonter tout le système d'écoute. Ils suivent les fils jusqu'au... standard téléphonique de l'entreprise ! Ils les ramènent le lendemain au secrétariat de direction : « "On a trouvé ça dans notre local", qu'on leur a dit. "Sans doute un hasard... On tenait à vous le rendre, au cas où vous en auriez besoin, hein !" »
Un beau jour, la direction générale de la multinationale décide de délocaliser toute la production vers les Pays-Bas (où la fiscalité est plus avantageuse) en emmenant par camions toutes les machines et marchandises en une seule nuit ! Pas de bol : lorsque les travailleurs arrivent sur les lieux au petit matin, plus de trois milliards de francs belges en marchandises sont encore dans le dépôt. Ils occupent l'usine : « Les 3 milliards, vous ne les aurez pas comme ça... » Ils négocient le reclassement d'une partie du personnel dans le nouveau siège néerlandais ainsi que des indemnités de départ pour les licenciés.
Le dernier stratagème mis en place par ce syndicaliste, juste avant la fermeture du siège, est sans doute le plus inouï de tous... C'est l'œuvre d'un esprit tordu : il sait que l'usine va fermer ; il connaît (grâce à la trahison d'un directeur) le montant total de l'enveloppe que la direction est prête à mettre sur la table pour payer les primes de départ des travailleurs licenciés ; enfin, il sait aussi (c'est là que ça commence à devenir tortueux) que la direction veut absolument faire porter la responsabilité de la fermeture sur les syndicats. Alors il va jouer : il fait croire à ses patrons que la délégation syndicale se désolidarise complètement de la base des travailleurs et qu'elle veut se mettre le plus d'argent en poche... « On leur a dit qu'on voulait d'abord se partager l'enveloppe entre nous et laisser quelques miettes aux travailleurs... Nous étions sept délégués à être licenciés. Avec notre protection, ça faisait beaucoup d'argent... » La direction marche : les primes de départ proposées aux délégués atteignent des sommes assez monstrueuses. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les sept délégués ont signé un document dans lequel ils déclarent remettre le moindre centime reçu dans un pot commun et partager la somme de manière strictement égale avec tous les ouvriers licenciés. « La direction m'en a beaucoup voulu. Ils m'ont dit : "Monsieur, vous êtes un malhonnête !" C'est vrai qu'eux, de leur côté, ils ont été un modèle d'honnêteté ! » (Rires.)
Conclusion de Charlotte : « On pourrait presque écrire un roman avec son histoire ! » — Un article de blog, c'est déjà un bon début, non ?