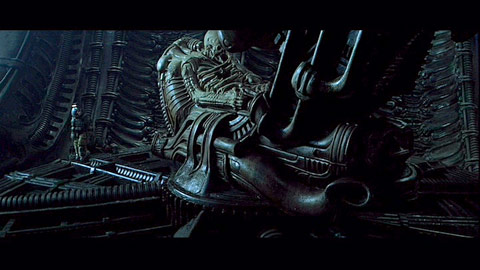Ce week-end, ma mère a exhumé une partie de mes « vieux papiers » : des exemplaires du journal que je rédigeais, d'abord sur machine à écrire puis sur Commodore PC-10, quand je n'étais encore qu'un gamin ; les bandes (mal) dessinées décrivant ma famille proche, réalisées un peu plus tard, à la sortie de l'enfance ; et enfin une nouvelle fantastique écrite en quatrième secondaire (1995-1996), intitulée Hiver noir à Middelheim. — J'attends toujours que ma maman retrouve dans son grenier ma toute première histoire, un sombre récit de pirates écrit en première primaire dans une orthographe plus que douteuse, que je me ferai un plaisir de poster ici-même lorsque je l'aurai en main, juste pour rigoler un bon coup.
En attendant, aujourd'hui, je me suis mis en tête de publier telle quelle la nouvelle susmentionnée. Il s'agit d'une bête enquête de détective privé au sein d'un supermarché démoniaque, débouchant sur une évocation très faiblarde et moralisatrice de la lutte entre le Bien et le Mal. Je n'ai effectué que quelques modifications mineures par rapport au texte original : correction de trois coquilles et de cinq fautes d'orthographe manifestes ; ajout/suppression de quelques majuscules et signes de ponctuation. Pour le reste, la forme comme le fond restent inchangés.
Deux constats : en premier lieu, le lecteur attentif s'amusera sans doute à retrouver dans ce texte des tournures de phrase, des idées et des « effets de style » qui me sont propres encore aujourd'hui (dans un sens, on pourrait dire que ce texte constitue une sorte de « forme primordiale » — une gestalt ? — de mon écriture actuelle) ; en second lieu, il sourira certainement devant le manque flagrant de maturité et de maîtrise de l'ensemble. On voit que je veux créer un suspense, mais je me ramasse lamentablement. — En bref : merci d'être indulgent ! J'avais à peine seize ans à l'époque et, pour couronner le tout, j'avais de l'acné !
Hiver noir à Middelheim
CHAPITRE PREMIER
« Sachez que vous n'êtes pas le premier à qui je viens demander de l'aide. Tous les autres ont refusé. »
La figure qui se trouvait de l'autre côté du bureau était celle d'un homme déchiré par la terreur et l'épouvante. Il venait d'entrer en poussant énergiquement la porte et s'était laissé tomber dans le fauteuil en cuir destiné aux clients.
« Tous les autres ?
— La police, la gendarmerie et quelques détectives de renom. »
D'épouvanté, le visage de l'homme devint déterminé :
« Je n'irai pas par quatre chemins, Monsieur : ça fait une semaine que je cherche en vain un homme capable de m'aider dans une affaire qui, je vous l'avoue, n'est pas des plus claires.
— Je vous écoute.
— Je suis veilleur de nuit depuis plus de vingt ans dans la grande surface du village voisin, Middelheim. Eh bien voyez-vous, ce supermarché, qui porte le nom d'Aubahn, est le théâtre de phénomènes étranges. »
Mon esprit de détective, rationnel, ne put s'empêcher de caler à l'idée qu'il s'agissait de « phénomènes étranges », mais je laissai continuer ce brave homme que je commençais à soupçonner d'être atteint d'un début de folie.
« Je sais que vous me prenez pour un fou, comme toutes les personnes que j'ai vues avant vous. Mais je m'obstine... Il faut me croire !
» Je suis veilleur de nuit, je vous l'ai déjà dit, et mon travail consiste à m'installer dans la salle de contrôle des caméras du magasin et de veiller à ce que tout soit en ordre. Travail tranquille, vous direz.
» C'est pendant que je lisais un livre, vers deux heures du matin, que le premier événement surnaturel apparut : les caméras se sont éteintes les unes après les autres et je ne voyais plus que...
— Il n'y a rien d'anormal à ça... Peut-être seulement une avarie.
— C'est ce que j'ai cru au début. Mais il n'y a pas que ça ! Soucieux de résoudre le problème, je suis descendu au sous-sol, là où se trouve la pièce dans laquelle tout le réseau électrique du magasin est installé.
— Et...
— Et je n'y suis jamais parvenu. La porte ne s'ouvrait pas.
— Allons, allons, c'était juste un problème de serrure, je ne vois pas de mystère dans tout ça.
— Ce n'était pas un problème de serrure, j'avais les clefs. Non, ce n'était pas ça ! Je sentais comme un force qui retenait la porte et contre laquelle je ne pouvais rien faire. Alors, je suis remonté : les caméras marchaient de nouveau et c'est à ce moment que j'ai vu la chose. »
Ça devenait de plus en plus saugrenu et je ne sus à ce moment que penser. Fallait-il le laisser poursuivre ? Je décidai de lui laisser une dernière chance de s'expliquer :
« La chose ?
— Oui, Monsieur, si l'on peut donner le terme de "chose" à l'abomination que j'ai vue ! Une matière verte et gluante qui s'étendait à vue d'œil sur les étagères. Elle sortait du carrelage et grimpait lentement sur les rayons en faisant tomber toutes les boîtes de conserve sur son passage. Répugnant ! »
Cet homme était fou, telle fut ma conclusion en entendant un tel délire. Oui, il ne pouvait être que fou, ou alors...
« Ne vous est-il jamais arrivé d'emporter de l'alcool à votre travail ? dis-je ironiquement.
— Vous prenez cette vision pour du delirium tremens ! Au travail comme chez moi, j'ai toujours été sobre !
— Soit. Et qu'avez-vous fait après la vision de cette créature ?
— J'ai éteint les caméras et je suis resté bloqué dans mon fauteuil tout le reste de la nuit. Et le pire, c'est qu'au petit matin, il n'y avait plus aucune trace ni de la chose, ni des dégâts qu'elle avait causés ! Tous les soirs, depuis cette nuit, j'ai peur de la voir arriver !
— Et ?
— Plus rien !
— C'est bien ce que je pensais, tout s'explique : vous avez paniqué lorsque les caméras sont tombées en panne et vous avez été victime d'une hallucination !
— Impossible !
— Qu'en pense votre chef ?
— Je ne lui en ai pas parlé ! Il me jetterait à la porte !
— Mouais, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, à part vous donner l'adresse d'un excellent psychiatre.
— Et un de plus ! »
Sur cette phrase, l'homme se leva, jeta désespérément une carte sur le bureau et s'en alla en claquant la porte.
Pierre Dumanoir
24, rue du Moulin
1211 Middelheim
TEL. : 080/24.06.54
Je savais maintenant que cet homme persévérant s'appelait Pierre Dumanoir.
CHAPITRE II
Les trois jours qui suivirent la visite du pauvre homme, je ne sus que penser de son histoire. Les récits narrant la présence de forces surnaturelles dans certains lieux, je n'y avais jamais cru.
Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, Pierre Dumanoir m'avait intrigué en racontant ses « mésaventures ». C'est pourquoi je pris la décision de me rendre à Middelheim et de mener ma petite enquête.
J'arrivai à la gare de Middelheim dans la soirée. Les deux villages étaient espacés de dix kilomètres et seuls deux trains s'arrêtaient par jour. C'est pour cette deuxième raison que je louai une chambre dans le seul hôtel de la localité.
C'est à sept heures que je me rendis pour la première fois au magasin qui avait causé tant de frayeur à ce cher Dumanoir.
C'était un magasin accueillant qui surplombait une petite colline légèrement boisée. Son parking s'étendait sur deux étages.
À l'entrée, un homme déguisé en pingouin — cet animal était sans aucun doute la mascotte du magasin — distribuait des prospectus. Il m'en donna un. C'était de la publicité pour la chaîne Aubahn. Sur le recto de la feuille, se trouvait l'image du pingouin habillé en Saint-Nicolas avec son inséparable crosse dans la main droite. Au verso, des bons d'achat.
J'entrai dans le bâtiment. Les premières choses qui attirèrent mon attention furent les six pingouins-Saint-Nicolas qui distribuaient des bonbons aux enfants. Je les observai un bon moment avant de reprendre ma route. Dix mètres plus loin, je me retournai de nouveau vers eux.
Un homme regardait fixement les palmipèdes avec un air inquiet. Mais oui ! Cet homme, c'était Pierre Dumanoir. Je ne l'avais même pas reconnu parmi la foule. Il était appuyé contre le mur d'entrée.
J'allai à sa rencontre, l'appelai. Pas de réponse.
J'arrivai derrière lui, lui donnai une tape amicale sur l'épaule.
Les événements se précipitèrent : Pierre tomba, raide comme un piquet. Je remarquai des tâches de sang sur ses vêtements à plusieurs endroits du corps, notamment au cœur. Je sursautai d'effroi : Pierre était mort. Un groupe de personne m'entoura. Mon esprit se troubla, mes yeux picotèrent, je vis deux employés s'approcher de moi. Des cris stridents me percèrent le tympan. Je m'évanouis.
CHAPITRE III
La pièce dans laquelle je me réveillai était remplie de fumée. J'étais couché dans un fauteuil et deux hommes étaient assis en face de moi.
« Vous voilà enfin réveillé. Je suis le gérant du magasin, Henri Brémontier. Et voici l'inspecteur Gérard Swift. »
L'inspecteur Swift, un gros moustachu qui fumait constamment la pipe, commença à parler d'une voix grave.
« Il y a eu un meurtre. Et qui dit meurtre dit coupable. Et qui dit coupable dit suspects. Or Monsieur, vous étiez sur le liste des suspects. Mais... Après examen minutieux de votre cas, je ne vous crois pas coupable. Car qui dit examen minut...
— Abrégeons, coupa sèchement Henri Brémontier.
— Hum... Vous ne portiez pas d'arme sur vous et tous les témoignages prouvent votre innocence. Vous allez donc seulement nous servir à voir un peu plus clair dans l'...
— Vous connaissiez la victime ? interrompit encore plus sèchement le gérant du magasin.
— Dites donc, est-ce vous ou moi qui menez l'enquête ? Connaissiez-vous personnellement la victime ?
— Je suis détective privé, vous le savez sûrement. Pierre Dumanoir était en quelque sorte un client.
— En quelque sorte ?
— Oui, j'ai refusé son affaire.
— Son affaire...
— Suis-je obligé de vous en parler ?
— Ça pourrait simplifier les choses. »
J'étais un peu méfiant. Raconter toute l'histoire à l'inspecteur Swift ne me dérangeait pas mais j'éprouvais une certaine antipathie à l'égard du gérant. Et puis, je briserais le secret professionnel. Mais je pensai à ce qu'aurait fait Pierre dans une telle circonstance : il aurait sans doute tout expliqué.
Je leur racontai toute l'histoire, sans en déformer une seule phrase.
« Sornettes ! Balivernes ! Si j'avais su ça, je l'aurais renvoyé sur le champ ! »
Je m'attendais à ce genre de paroles de la part de Brémontier. Par contre, la conclusion de Swift était beaucoup moins prévisible :
« Le rationnel n'a pas réponse à tout, mon cher Brémontier. Vous avez encore à apprendre. »
La remarque était d'autant plus bizarre qu'elle émanait d'un policier. De plus, elle avait été formulée à la manière de l'instituteur qui réprimande l'élève.
L'inspecteur changea subitement de sujet.
« Vous n'avez rien remarqué de particulier lorsque vous avez découvert le cadavre ? Quelque chose de louche ?
— À part les pingouins, rien.
— Les pingouins ? demanda le gérant d'un air étonné.
— Oui. Les hommes déguisés en pingouin à l'entrée. »
Le vieil homme éclata de rire.
« Bon sang, s'il y avait eu des pingouins dans mon magasin, je le saurais. Où vous croyez-vous ? En Arctique ?
— Je les ai vus, je vous dis ! Ils donnaient des bonbons aux enfants.
— Écoutez, n'importe quel gamin du village vous dira qu'il n'a jamais vu de pingouins dans mon magasin. Et il ne mentira pas puisque je n'ai jamais acheté de déguisements. »
Je vis à son regard qu'il ne plaisantait pas et ressentis le sentiment qui avait dû tant de fois assaillir Pierre Dumanoir : le sentiment d'être pris pour un fou, un anormal.
Swift ne disait rien. Il semblait me comprendre. Je sortis de la pièce en claquant la porte.
Durant tout l'interrogatoire, aucun élément ne m'avait permis de savoir où je me trouvais et quelle heure il était. Il était minuit et j'étais au rez-de-chaussée du commissariat.
Je marchais dans les rues étroites qui menaient à l'hôtel quand l'inspecteur vint me rejoindre pour me dire quelques mots.
« Le temps qui m'était imparti pour chasser Brémontier est écoulé. Je dois retourner chez moi, très loin. Plus loin que vous ne le pensez. Beaucoup plus loin. »
Sur ces mots, il disparut dans les ruelles aussi vite qu'il n'était apparu.
Un personnage mystérieux, ce Swift.
CHAPITRE IV
La bibliothèque de Middelheim était aménagée dans l'ancienne école du village. Elle se trouvait dans la prolongation d'une petite allée de chênes qui devaient certainement avoir été plantés au siècle dernier.
Dès le moment où j'ouvris la porte, l'odeur des vieux bouquins me submergea. L'intérieur était composé de deux pièces : une grande salle dans laquelle les livres débordaient des rayons et une plus petite qui semblait servir de salle de lecture.
J'entrai dans la grande salle.
« Tiens ! Un client ! Les clients se font rares, vous savez. C'est bien dommage. Les gens ne lisent plus assez ! »
La bibliothécaire lisait un roman d'épouvante. Elle le posa.
« Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
— Je recherche des journaux ou des chroniques relatant certains faits qui se seraient passés dans le magasin Aubahn.
— Drôle d'idée. Je vais vous trouver ça. »
La femme se leva et se perdit dans les hautes étagères.
« Voilà. J'ai trouvé, tenez. Vous avez de la chance. On a fait beaucoup d'articles sur ce magasin. Je me souviens, ils ont eu beaucoup de mal à l'édifier.
— Ha bon ?
— Oui. Figurez-vous que les architectes n'avaient pas pris en compte le fait qu'ils construisaient Aubahn au-dessus des galeries de l'ancienne mine. Tout est marqué dans les journaux. Vous les lirez chez vous ?
— Non, non, je vais m'installer dans la salle de lecture. Merci. »
Je lus une dizaine d'articles que l'on pouvait résumer comme ceci.
C'est en janvier mille neuf cent soixante-huit que Gustave Aubahn décida de construire son neuvième magasin à Middelheim.
Les constructeurs eurent effectivement quelques difficultés : ils avaient négligé l'existence des tunnels souterrains de l'ancienne mine de charbon.
Brémontier fut nommé gérant dès l'ouverture du magasin. Il ne se passa rien durant plus de onze ans.
Le douze février mille neuf cent quatre-vingts, une jeune cliente fut retrouvée déchiquetée dans le rayon boisson du magasin. La presse resta très discrète à ce sujet. Le criminel ne fut jamais retrouvé.
Il n'y eut plus d'événements de ce genre jusqu'à la mort de Pierre Dumanoir.
Je n'arrivais pas à faire une liaison entre ces deux meurtres.
Alors que je rangeais les journaux, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Des bruits de pas résonnaient de plus en plus fort. Quelqu'un entra dans la pièce.
« Vous devriez partir avant qu'il ne soit trop tard. »
J'avais déjà entendu cette voix. Je me retournai : c'était Pierre Dumanoir. J'étouffai un cri.
« Je vous donne un dernier conseil avant de partir pour l'éternité : allez-vous-en. Rentrez à l'hôtel, faites vos valises et allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont déjà à vos trousses !
— Que... Comment ?
— Vous avez appelé ? demanda la bibliothécaire dans l'autre pièce.
Pierre Dumanoir n'était plus là. Il m'avait parlé sur un ton monocorde, dénué de toute vie, et avait disparu.
CHAPITRE V
Les premiers flocons de neige tombèrent dès la matinée. Au crépuscule, les routes étaient impraticables.
Il fallait pourtant que je sorte : je devais mettre un terme à toutes ces énigmes, même après le terrible avertissement d'hier.
Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce que j'avais vu. Je devais pourtant me rendre à l'évidence : ce qui se passait dans Middelheim était quelque chose d'extraordinaire, inexplicable par la science.
Je sortis aux environs de six heures et demie. Une brise glacée me balaya le visage dès l'ouverture de la porte. Je sentis le froid s'imprégner en moi malgré la grosse écharpe en laine qui me couvrait une grande partie du visage.
Le parking du magasin était désert. Pas une seule voiture. Il y avait de l'agitation à l'intérieur du bâtiment.
J'entendis un hurlement. Un homme sortit du magasin en courant. Un pingouin le pourchassait muni d'une hache. Cette dernière s'abattit dans le dos du malheureux, qui s'écroula instantanément. L'oiseau retourna dans le magasin.
Tout à coup, ce fut la panique. Des personnes s'enfuirent en tous sens, poursuivies par la bande de pingouins. Une vision d'horreur. Je ne savais rien faire.
C'était affreux. Plus de vingt cadavres gisaient dans la neige — si l'on pouvait encore appeler ça de la neige.
J'étais terrifié.
Une voix démoniaque résonna. Il m'était impossible de savoir de quel côté elle venait. Peut-être n'existait-elle que dans ma tête.
« Monsieur le détective... Monsieur le détective... Allons, n'ayez pas peur. Avouez que ce n'était pas très prudent de rester. »
La voix qui me parlait n'était pas celle d'un homme ou d'une femme. Une personne capable de produire un tel son ne pouvait être totalement humaine.
« Vous allez vous diriger vers l'entrée du magasin. N'ayez pas peur. Mes gardes ne vous feront aucun mal. »
Je ne pouvais refuser. La voix m'hypnotisait. Je rentrai dans le magasin. Les pingouins ne me firent effectivement aucun mal.
« Vous allez maintenant vous rendre au sous-sol. »
Pendant que j'avançais, la voix continuait à vibrer.
« Tous les éléments perturbateurs, j'ai dû les éliminer. Il y a d'abord eu cette jeune fille, qui a vu ce qu'il ne fallait pas voir, dans le rayon boisson. »
» Pierre Dumanoir savait, lui aussi, bien trop de choses. Et maintenant il y a vous. Vous, le minable détective. Mais je ne vais pas vous tuer avant de vous avoir dévoilé le secret. Vous avez bien le droit de savoir, non ? »
La porte du sous-sol était ouverte. Tout en descendant, je vis dans la pâle lumière la tête d'Henri Brémontier. Je découvris une seconde plus tard le corps sur lequel elle était « fixée ». Ce n'était pas un corps humain. C'était une matière verte et gluante qui ressemblait étrangement à celle que Pierre avait vue dans les rayons du supermarché.
« Qui êtes-vous ? »
J'avais dit lentement ces mots en essayant d'articuler le mieux possible malgré la paralysie causée par la terreur.
« Je suis le Mal. Je suis une de ces créatures qui existent depuis la nuit des temps et qui incarnent le côté sombre de l'âme humaine. »
» Je suis l'intolérance, je suis l'égoïsme, l'orgueil, l'indifférence, la méchanceté, l'avarice, la violence, le mensonge. Je suis tout ça en même temps, je suis le Mal.
— Qui vous a créé ?
— Qui ? Haha ! Mais vous, bande d'imbéciles. Depuis que la race humaine et son intelligence existent sur la Terre, la haine n'a jamais quitté le monde ! C'est vous, avec vos guerres stupides, vos génocides sanglants, qui m'avez inventé. »
Je n'osai placer que trois mots.
« Et le Bien ?
— Le Bien est là, hélas, et il m'a retrouvé. Il va falloir que je change encore d'endroit. Il se trouve lui aussi dans l'esprit des hommes. C'est lui qui nous persécute. Je me cachais sous la couverture d'un gérant de magasin depuis plus de vingt ans. Mais il a découvert ma cachette. Ils vont bientôt venir à ma rencontre.
» Je sais que tu ne comprends rien à mon histoire. Ça n'a aucune importance de toute façon. Je vais te tuer. »
J'essayai désespérément de « ralentir » la mort.
« Et les pingouins ?
— Les pingouins ne sont rien d'autre qu'une partie de moi. Leur forme n'est qu'illusion. Derrière leur costume, se cache la même matière que celle qui me compose. Je m'étais servi de cette matière pour effrayer Pierre Dumanoir — un de mes passe-temps, en quelque sorte — mais celui-ci commençait à en savoir un peu trop, comme toi... Tu vas mourir, maintenant. »
Il y eut un bruit dans les escaliers. Je me retournai. Les pingouins arrivaient et déjà levaient leur hache.
Les lames s'abattirent sur moi. Je fermai les yeux. Quand je les rouvris, il n'y avait plus de pingouins, plus de haches, et plus de Brémontier. Une personne se tenait immobile dans les escaliers. Je reconnus Swift.
« Je suis revenu », dit-il simplement.
ÉPILOGUE
L'inspecteur était assis en face de moi dans le fauteuil destiné aux clients.
« Et voilà, Swift, Middelheim peut dormir sur ses deux oreilles : son magasin n'aura plus jamais de démons comme locataires. Vous avez détruit le Mal sans grande difficulté.
— Ne soyez pas si naïf, je n'ai fait que le chasser. Détruire le Mal, ce serait détruire l'humanité toute entière.
— Vous voulez dire que le Mal peut apparaître n'importe où et n'importe quand ?
— Bien sûr. Sans lui, l'équilibre de l'Univers tout entier serait menacé. Je n'ai fait que l'éloigner. »
Il y avait une question qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps. Je devais la poser.
Je marchai vers la fenêtre et regardai les gens, en bas dans la rue, avant de demander...
« Qui êtes-vous, Swift ? »
Je me retournai et découvris avec rage que je parlais à une chaise vide.