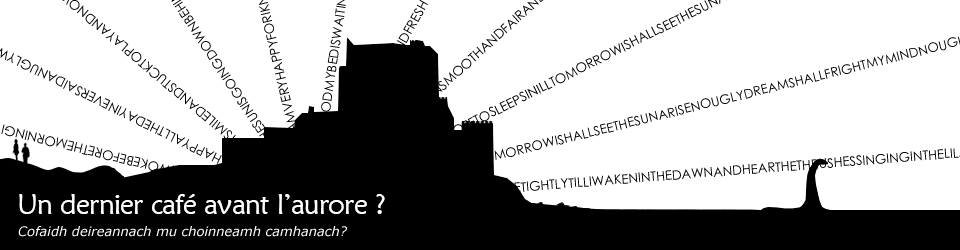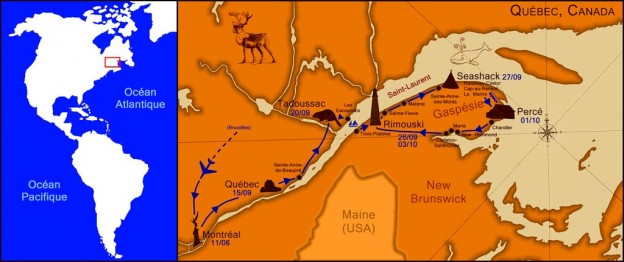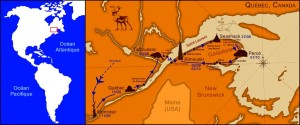Filigranes. — Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Walter pour un troisième après-midi consacré aux Colons de Catane (le vrai jeu de plateau, évidemment, et non son homologue en ligne). Avant de m'y rendre, je passe en vitesse chez Filigranes, la librairie dont Léandra et Andrew n'arrêtent pas de me dire le plus grand bien, située le long de la petite ceinture de la ville, à quelques centaines de mètres du métro Arts-Loi...
Sa devanture rouge et blanche est facilement reconnaissable. À l'intérieur, une profondeur que jamais je n'aurais soupçonnée si je m'étais contenté de rester dehors sous la pluie. Après avoir remis mon sac en bandoulière à un gentil garde très poli (ça existe), je pars à la recherche du coin « Philosophie ». — Un jour, il faudra que j'y retourne pour jeter un œil aux rayons « Science-fiction », « Fantastique » et « Bandes dessinées ». Aujourd'hui, je n'ai pas le temps... Ce sera la philo et puis c'est tout ! Je traverse donc sans m'y arrêter ce qu'ils appellent le « cafffé » : un endroit, plus ou moins central, où les familles peuvent s'asseoir pour déjeuner, et les solitaires se poser pour lire un livre...
Silence & hauteurs. — Partie « Philosophie » de la librairie : déserte, en retrait, loin de l'agitation et des enfants qui courent. Dans un coin, une vendeuse regarde son ordinateur et ne dit mot. Les étagères de livres sont hautes et demandent quelquefois l'utilisation d'un escabeau.
Je regarde d'abord à « S » comme "Schopenhauer"... Ils ont Le monde comme volonté et représentation, dans deux éditions différentes : d'abord celle en un seul volume, couverture rouge, reprenant la traduction d'Auguste Burdeau, qui commence à dater (1885) ; ensuite celle, en deux volumes de poche, avec sa toute nouvelle traduction (Gallimard, 2009). La taille des caractères de la première traduction est minuscule, à tel point qu'il me faudrait presque une loupe pour arriver à déchiffrer le texte. Je choisis donc le premier des deux tomes de la nouvelle édition (1134 pages bien tassées, en comptant l'appareil critique).
Je regarde ensuite à « K » comme « Kierkegaard » (partie supérieure d'une étagère) et sélectionne un recueil de trois textes : Miettes philosophiques, Le concept de l'angoisse et Traité du désespoir. — Lu en vitesse, dans le sommaire des Miettes, ce sous-titre énigmatique : « INTERMÈDE. Le passé est-il plus nécessaire que l'avenir ? ou Pour être devenu réel le possible en est-il devenu plus nécessaire qu'il ne l'était ? » (Kierkegaard se cognait-il lui aussi la tête contre les murs de sa cage en se posant des questions qu'il n'aurait pas dû se poser ?)
Enfin, je regarde à « W » comme « Wittgenstein », évidemment. Grands dieux, ils ont une rangée entière d'écrits de lui et sur lui : les textes majeurs (le Tractatus, les Recherches, De la certitude...) mais aussi, par exemple, ses « carnets secrets » (écrits en 1914-1916, durant sa participation à la Première Guerre mondiale) ainsi qu'une récente édition de sa correspondance avec l'architecte Paul Engelmann (1916-1937). Il faudra que je me procure tout cela petit à petit. En attendant, j'opte pour Ludwig Wittgenstein, une introduction de Chiara Pastorini, toujours dans mon optique de tout faire à l'envers : lire les modernes avant les anciens, me plonger dans les textes originaux avant de lire des introductions au sujet, etc.
Ces trois philosophes ont en commun de proposer un système de pensée fondamentalement différent du mien. En sortant de la librairie, je me suis posé la question suivante : pourquoi suis-je attiré actuellement par Wittgenstein et non plus par Russell (pourtant beaucoup plus proche de mes convictions) ? Pourquoi Arthur Schopenhauer et non, à ses antipodes, les néo-positivistes du Cercle de Vienne ? Pourquoi Kierkegaard, l'existentialiste chrétien ? La réponse est assez simple : en lisant des penseurs avec lesquels je suis en phase, je n'apprends strictement rien de nouveau ; je ne fais que conforter mon cadre de certitudes, de convictions... Par contre, en parcourant — et en essayant de comprendre — les paysages lointains et étrangers de la philosophie, je m'ouvre à d'autres formes de pensée : à défaut de sortir de mon cocon matériel (mon petit cercle d'amis, « ma » Maison du Peuple), au moins je sors de mon cocon intellectuel, et saute dans l'inconnu.
Et puis, il y a le fantôme de Goethe et la fureur rigoureusement analytique de la pensée allemande...
Catane chez Walter. — Lorsque j'arrive chez lui, un peu avant 14 heures, Walter m'apprend que Mary a fait faux bond. Elle devait venir jouer avec nous cet après-midi mais n'arrive pas à se lever à cause, si j'ai bien compris, d'un space cake qu'elle aurait ingurgité en trop grande quantité hier soir. Nous ne sommes donc que quatre pour ce troisième après-midi « Colons de Catane » : Emily, Walter, Frédéric et moi. — Frédéric : l'ami historien de Walter, que nous avions déjà aperçu lors de la pendaison de crémaillère (le samedi 17 septembre 2011) et la soirée d'anniversaire de ce dernier (le vendredi 14 octobre suivant). Walter a rempli son frigo de bières, de sushis, d'une tarte... Croyant que nous serions cinq, il a vu trop grand... En outre, il aurait bien aimé jouer avec l'extension pour cinq ou six joueurs. Moi aussi, mais ce sera pour une autre fois (le mois prochain ?).
Frédéric n'a jamais joué aux Colons de Catane de sa vie, mais apprend vite. Nous lui expliquons comment se débrouiller avec l'extension « Villes et chevaliers » (qui n'est certainement pas la plus simple, surtout de prime abord) et il comprend rapidement le concept. Il s'en sort même sans problème lors de la première partie et gagne presque la deuxième. C'est parce qu'il possède « l'esprit jeu » : il a l'habitude des jeux de société, donc il appréhende plus facilement les règles d'un nouveau monde (la remarque vaut sans doute aussi, par exemple, pour Amy et Zapata).
Je gagne les deux premières parties. Frédéric s'en va vers six heures et nous en rejouons une dernière, très serrée, qui sera au final gagnée par Walter... Comme d'habitude, Walter propose d'aller boire un verre au Corto. Comme d'habitude, j'accepte. Comme d'habitude, Emily nous reconduit en voiture. Être au Corto, avec Walter, un dimanche soir : ce n'est pas le bon moment pour arrêter de boire des Chimay... Tant pis : le « régime » attendra demain.