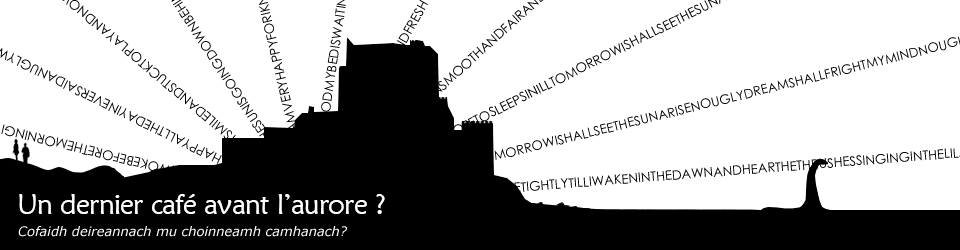Mes études d'histoire médiévale ressurgissent et j'ai également envie d'acheter une partie de la librairie, non pas les livres sur sœur Emmanuelle mais une bible œcuménique, un petit livre bleu contenant la règle de saint Benoît et des versions commentées des quatre évangiles... Je me retiens néanmoins car 1) je n'aurai pas le temps de les lire et 2) je ne sais pas ce que valent ces éditions sur le plan scientifique...
Nous allons nous installer à une table pour boire un verre, à l'intérieur de la cantine proche de la boutique. La salle est majoritairement remplie de vieux. Par-ci, par-là, quelques nonnes et, en face de notre table, un groupe de jeunes anglaises (ça rafraîchit). Nous irons ensuite boire un deuxième verre dehors, pour profiter des premiers rayons de soleil de l'année...
Une jeune et jolie princesse en âge de se marier est envoyée par sa mère la reine dans un royaume lointain pour épouser un jeune prince. Avant son départ, la princesse reçoit de sa vieille maman des objets précieux en guise de dot ainsi qu'un cheval intelligent du nom de Falada, qui a — c'est magique ! — la faculté de parler. La vieille reine adjoint également à sa fille une camériste (une servante) pour les besoins du voyage et lui donne enfin un mouchoir imprégné de trois gouttes de son propre sang, censées lui apporter force et protection tout au long du trajet.
Durant le voyage, la princesse perd son mouchoir alors qu'elle boit à un ruisseau. La camériste le remarque et, sachant alors que sa maîtresse n'est plus protégée par le sang de sa mère, en profite pour l'attaquer et la forcer à échanger ses vêtements avec les siens. Elle l'oblige également à promettre de ne jamais raconter cette triste péripétie à quiconque. — Ouuuuh, la méchante !
Lorsqu'elles arrivent au château du roi étranger, la camériste déguisée en princesse devient la fiancée officielle du jeune prince, pendant que la vraie princesse, en haillons, est reléguée à la garde des oies du château — quelle honte ! La camériste déguisée en princesse est vraiment très, très pas zentille, alors elle ordonne à l'équarrisseur — tadaaam ! — de couper la tête de Falada le cheval, car elle sait que la brave bête a tout vu et pourrait donc révéler la vérité. Le vraie princesse arrive néanmoins à faire en sorte que la tête de son cheval adoré soit accrochée à l'une des portes de la ville, afin qu'elle puisse toujours l'observer et lui parler lorsque, chaque jour, elle promène ses oies hors les murs.Ainsi, chaque matin et chaque soir, en compagnie d'un autre gardien d'oies du nom de Conrad, elle salue la tête de son cheval par une phrase du genre (ça dépend des versions) : "Ô, mon Falada, comme tu es cloué là !", à laquelle Falada répond par ces mots : "Ô princesse, ma princesse, comme tu vas là, si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats !". Il y a également un épisode très amusant durant lequel Conrad, à plusieurs reprises, essaie d'attraper l'un des cheveux d'or de la princesse, en vain... (Est-ce une métaphore sexuelle ? — Oh bah oui, sans doute, hein !)
Toujours est-il que Conrad finit par parler au roi et que ce dernier convoque la princesse gardienne d'oies pour lui demander la raison de son comportement bizarre — car parler à la tête d'un cheval ne se fait apparemment pas dans ce royaume, surtout si l'animal répond par une réplique encore plus étrange, en faisant rimer certains mots... La princesse a promis de ne rien dire, alors elle ne dit rien — ça, c'est de la promesse ! — mais le roi trouve un subterfuge : il propose à la princesse d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur auprès d'un poêle (!). Le roi, qui est sorti de la pièce, entend néanmoins la confession de la jeune femme en plaçant subtilement une oreille contre le tuyau de la cheminée : il apprend alors que la princesse s'est vue dans l'obligation de changer ses vêtements avec ceux de la camériste, qui est une vile usurpatrice, etc.
Et c'est là que ça devient gore : le roi convoque un banquet auquel tout le monde est prié d'assister (la vraie princesse, la camériste qui a usurpé son rôle, le prince...). Le roi demande alors à la camériste, qui ne se doute de rien : "Que peut valoir une servante qui aurait trompé tout son monde ?" Réponse de la camériste (un rien stupide, pour le coup) : "Elle ne vaut pas mieux que d’être placée nue dans un tonneau garni de clous pointus attelé à deux chevaux blancs qui la traîneront de rue en rue jusqu’à ce que mort s’ensuive". Ni une, ni deux, la sanction est appliquée à la camériste... Et tout est bien qui finit bien, youpie !
La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Frérot et Sœurette, dans laquelle il est notamment question d'un petit garçon transformé en chevreuil, d'un roi qui propose à une petite fille de devenir son épouse (mais quel âge a-t-elle, bon sang ?), d'assassinat politique (par crémation) et, une nouvelle fois, de justice royale sans pitié : on brûle la sorcière et on conduit sa fille dans la forêt où les bêtes sauvages la déchirent en mille morceaux... Haaaa, les contes de jadis, y a pas à dire : ça avait de la gueule, crévindiou !