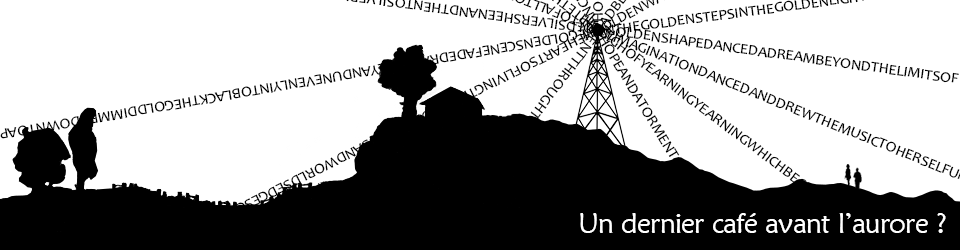L'ouvrage s'ouvre, non pas sur Russell en 1939, mais sur Apostolos Doxiadis, mathématicien-écrivain et scénariste de la BD. Dès la sixième case, Doxiadis nous "parle" directement, il brise le quatrième mur : Doxiadis "voit" que nous sommes là et nous propose de le suivre pour rencontrer un de ses potes, Christos Papadimitriou, chercheur en informatique théorique, avec qui il va travailler sur le projet
Logicomix.
Autoréférence, onanisme intellectuel et manque flagrant d'humilité
Car voilà : faire une BD sur Russell et les logiciens ne suffisait pas, non, non et non ! Il a fallu que les auteurs s'intègrent eux-mêmes dans leur œuvre, qu'ils se mettent à l'avant-plan, qu'ils fassent dans l'autoréférence afin de montrer leurs hésitations, leurs doutes, leurs petites chamailleries quant au cours que devait prendre leur histoire. Dès les premières pages, j'ai détesté ce procédé, non pas pour l'artifice en tant que tel mais parce que, dans ce cas précis, il n'améliore en rien le récit, contrairement à ce que croient dur comme fer lesdits auteurs. L'autoréférence, utilisée à bon escient, peut pourtant apporter beaucoup à une BD. Par exemple, dans Maus, Spiegelman utilise le même procédé pour créer une distance entre l'histoire réelle de son père et celle – forcément subjective – qu'il couchait sur le papier...
Ici, rien à voir... Imaginons le tableau... Bertrand Russell parle de sa vie à un parterre d'étudiants : il revient sur son enfance à Pembroke Lodge, sur ses premières découvertes, sur ses rencontres décisives, sur ses amours... Et puis – badaboum ! – retour au XXIe siècle et zoom sur les auteurs, qui ne peuvent pas s'empêcher de ramener leur fraise. Ils sont d'un orgueil démesuré, alors que le sujet aurait nécessité au contraire énormément d'humilité. Le dessinateur les représente toujours avec de petits yeux blasés, arborant un sourire ironique, genre "chuis universitaire et j'ai tout compris, ô lecteur !". Même le petit chien, "Manga" ("mec sympa" en argot grec, nous dit-on), est antipathique et sans relief (à la fin de l'histoire, il emmerde une chouette qui ne lui a rien demandé). Bref, c'est horripilant, mais ça passe encore.
Ça passe beaucoup moins quand les auteurs remplissent leurs phylactères – au lettrage mal centré soit dit en passant, mais peut-être est-ce là un défaut de l'édition francophone uniquement ? – d'autosatisfaction. Leur projet de BD ? "Franchement la chose la plus démente que j'aie jamais entendue !" (Christos, p. 22). La tautologie ? "Je sais ce qu'est une tautologie, merci ! Mais le lecteur moyen le sait-il, lui ?" (Christos, p. 97). La fidélité du dessin ? "Le petit garçon ressemble-t-il vraiment au petit Kurt Gödel ? — Son portrait craché !", répond le dessinateur (p. 199). Le Tractatus logico-philosophicus ? "Franchement, pour moi un des dix livres les plus surévalués !" (Christos, p. 265). Ben voyons... Tout comme Logicomix ?
Les deux chapitres les plus horribles en termes d'autoréférence sont ceux intitulés "Entracte" et "Finale", dans lesquels toute l'intrigue se déroule au XXIe siècle et s'éloigne du sujet. Les auteurs se disputent quant au fond de l'histoire : est-ce le chemin emprunté, avec tous ses tournants et ses culs-de-sac, ou la morale finale qui compte ? La logique est-elle "fille de la folie" ? Bref, des questions qui auraient dû être réglées avant d'écrire le scénario et non pas intégrées dans celui-ci.
Durant l'entracte, nous accompagnons Christos et Anne (celle qui s'est occupée de la recherche visuelle et du lettrage de la BD) à une répétition de théâtre. Christos n'arrête pas de lui parler de logique (et d'algorithmes), à la manière de Russell avec ses différentes épouses. La balade est l'occasion pour lui de visiter Athènes la nuit, qu'il ne reconnaît plus : il est très étonné de voir, dans un quartier qu'il connaissait bien, des prostituées, un magasin chinois, ainsi qu'un coiffeur avec une enseigne en hindi (oui, et ?). Il se fait harceler par un clochard pas net, puis se fait voler son portable par un "voyou". Ces quelques pages pourraient presque illustrer un tract du Front national sur "la déliquescence de notre belle société occidentale". Bon, OK, j'exagère un peu mais ça m'a marqué, tout de même : qu'est-ce que cette putain d'histoire de quartier pas sûr vient foutre dans l'histoire d'une "quête des fondements" ?
Même remarque pour la fameuse finale, où nous sommes tenus d'assister à l'Orestie d'Eschyle, qui permet aux auteurs de continuer leurs digressions et d'établir des liens ténus entre les différents aspects du récit (comparaison entre la rage des furies et la rage d'Hitler, mise en avant de la force de la raison, etc.). Trois niveaux chronologiques ne suffisaient donc pas : il fallait en rajouter in extremis un quatrième, ancré dans la Grèce antique. C'est maladroit, barbant et somme toute très pédant.
Graphiquement bon mais sans plus
Et les dessins dans tout ça ? Hé bien ils sont grosso modo dans le style de la ligne claire... Heureusement d'ailleurs, au vu de la difficulté et de la complexité du propos ! Dès la première page, j'ai néanmoins l'impression de voir une référence explicite à Scott McCloud, l'auteur de BD américain à l'origine de plusieurs essais théoriques sur la BD (dont le célèbre Art Invisible, 1993). McCloud, dans ses BD théoriques tout au moins, s'adresse lui aussi directement à ses lecteurs.
Pour le reste, le dessin reste assez banal, un peu fade. Je ne dis pas qu'Alecos Papadatos ne sait pas dessiner, mais simplement qu'il ne dessine pas comme quelqu'un qui est censé cosigner "le plus extraordinaire roman graphique de tous les temps". Tout n'est pas négatif, loin de là (ha bon ?) : il y a malgré tout une preuve certaine de savoir-faire : on reconnaît directement chaque personnage... Le "vieux Russell" ressemble au vieux Russell, avec son éternelle pipe ; Wittgenstein (assez réussi) ouvre, sur chaque case où il apparaît, ses grands yeux de génie excentrique... Revers de la médaille : le tout reste assez figé et il est possible de trouver des pages entières sans presque aucune variation de visage (à ce sujet, les scènes décrivant la conférence de 1939 sont assez exemplatives – voilà, j'aurai au moins placé un belgicisme dans ce texte).
Et puis, pourquoi toutes ces bulles gorgées de longues explications ? C'est un gâchis tellement dingue que j'ai du mal à y croire : nous avons devant les yeux une BD qui traite de philosophie et de logique, mais qui n'exploite pas l'immense possibilité du média. Quitte à copier Scott McCloud, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout ? Pourquoi ne pas avoir remplacé ces centaines de cases remplies de gros phylactères gorgés de textes par des schémas, des dessins expliquant plus légèrement certains concepts ? Mis à part quelques exemples rapidement expédiés (comme le paradoxe du barbier, représenté sous la forme d'un dessin plus "cartoon" qui ne paie pas de mine), rien, nada, que dalle.
Et sinon, ça parle de quoi ?
Enfin, un dernier constat : ce livre traite de tellement de sujets à la fois qu'il est difficile d'en connaître le thème principal. En bref :
ça parle de quoi tout ce bazar ? De la quête des fondements des mathématiques ? De la philosophie humaniste de Russell ? De sa vision du pacifisme et, au-delà, de son avis sur la Seconde Guerre mondiale ? Du rapport entre les questions posées par la tragédie grecque et le monde contemporain ? De l'apport des logiciens de la première moitié du XXe siècle à l'informatique ? Ou tout simplement de la manière d'écrire un roman graphique sur la "quête des fondements" ?
Les auteurs savaient-ils eux-mêmes où ils mettaient les pieds ? S'ils avaient su ce qu'ils devaient écrire, ils auraient pu supprimer sans problème un des niveaux : celui de l'autoréférence, cette partie futile où ils se mettent constamment en avant. La BD aurait gagné en fluidité : Russell parlant de son passé, c'eût été parfait, plus intéressant et beaucoup moins lourd. Seulement voilà : j'ai comme l'impression que ce livre est autant une apologie de Doxiadis, Papadimitriou et consorts qu'un retour sur la vie de Russell... Ou bien tout simplement une expérience qui a permis à quelques universitaires de digérer une matière et de faire leurs dents dans le monde de la bande dessinée.
À force de vouloir traiter de tout, ce livre traite de... pas grand chose. Les auteurs prennent de grandes libertés avec l'histoire, inventant des rencontres qui n'ont jamais eu lieu : ce n'est dons pas un livre à vocation historique. Et malgré de nombreuses conversations, les questions de logique et de philosophie ne sont qu'effleurées : ce n'est donc pas non plus un livre de vulgarisation (à moins de ne pas du tout connaître le sujet).
Je ne sais donc toujours pas quel est le sujet central de cette BD. Ce n'est pas grave : ça ne m'empêchera pas de dormir la nuit... Quoique...